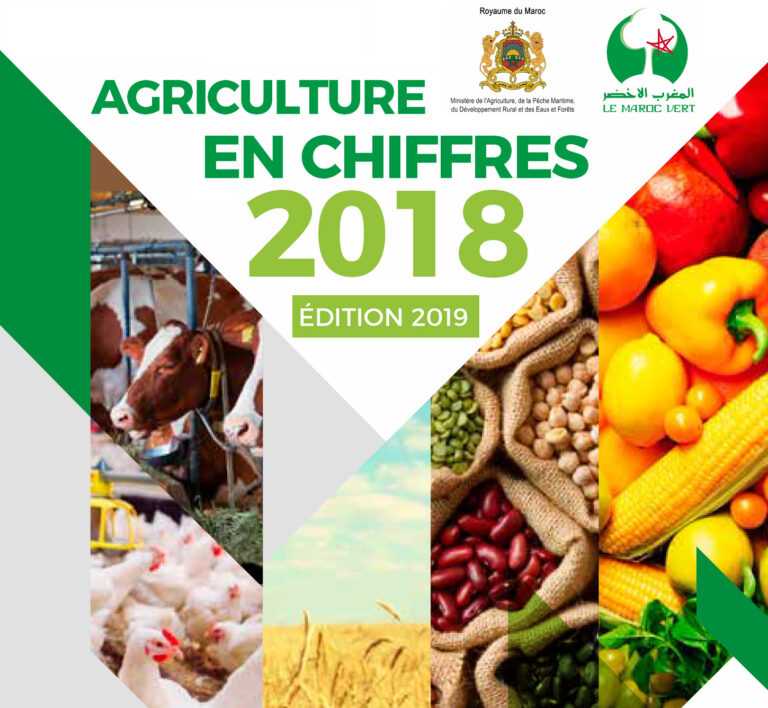Introduction
Au Maroc, où l’agriculture contribue de manière significative à l’économie nationale et emploie de nos jours 37% de la main d’œuvre, les politiques agricoles suivent la vision des institutions mondiales en termes d’amélioration des circuits de production, de commercialisation et de valorisation des produits alimentaires. Le Plan Maroc Vert (PMV), répondant dans sa première phase à un impératif majeur, celui de la sécurité alimentaire, l’ambition s’inscrit désormais dans une optique de développement économique, en s’intéressant à présent à promouvoir les circuits de post-récolte: la commercialisation et la valorisation. Pour la filière pomme de terre, les producteurs n’arrivent pas à être compétitifs sur le marché et à se dégager des niveaux de marge suffisamment rémunérateurs. Pourtant, au cours des dernières années, ce tubercule a acquis une place de choix dans le modèle de consommation alimentaire marocain aux côtés des céréales et du lait. La filière pomme de terre a donc acquis un poids considérable dans l’économie agro-alimentaire du pays, mais la construction d’une filière réellement performante reste encore inachevée.
Problématique
Ce travail de recherche vise à entreprendre une analyse complète de la chaîne de valeur de la filière pomme de terre dans les régions TTH et CS, afin de répondre à une problématique majeure: comment améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur pour les producteurs de pomme de terre et s’assurer qu’ils génèrent de la valeur ajoutée régulière et durable ? En conséquence, les questions spécifiques qui se posent sont:
• Comment est structurée la filière «pomme de terre» et quelles sont les marges de gain des différents maillons de la chaîne ?
• Quel modèle d’organisation permet de renforcer le poids économique de la filière et d’assurer une meilleure équité dans la distribution de la plus-value ?
Les hypothèses de travail que nous voulons vérifier se présentent alors comme suit:
• H0: La chaîne de valeur de la pomme de terre se caractérise par une distribution inégale de la valeur ajoutée et une concentration sur un seul acteur qu’est l’intermédiaire commercial;
• H1: L’agrégation agricole garantit une valorisation et une rentabilisation de la culture.
Méthodologie
La première phase du plan méthodologique est la réalisation, au niveau des régions CS et TTH, d’un diagnostic de l’existant pour l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur de la pomme de terre. De la production à la commercialisation en passant par la valorisation, tout en indiquant le mode d’organisation et la structure actuelle de son marché. La deuxième phase s’intéresse à l’analyse approfondie de la chaîne et à la proposition d’un plan d’action pour le redressement de son état.
Des guides d’entretien et/ou des questionnaires d’enquêtes sont conduits auprès de chaque maillon pour la récolte des données. Ces outils ont porté sur les communes de Laouamra et Boulaouane respectivement sur 21 et 19 producteurs de pomme de terre et 2 coopératives. Le spectre de nos investigations compte également pour les intermédiaires commerciaux: 3 grossistes, 4 marchands /détaillants, 2 vendeurs ambulants, 2 distributeurs, 2 supermarchés, et 3 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). Nous avons pu toucher pour les autres maillons 3 unités frigorifiques, 2 transformateurs agréés (un pour les pommes frites et l’autre pour les chips), un transformateur de pommes frites opérant dans le circuit informel et enfin 17 ménages et 8 restaurateurs/hôtels pour la catégorie du consommateur.
Dans un premier lieu, nous réalisons le diagnostic de l’état actuel de ladite filière à travers la recherche bibliographique et nos investigations sur l’organisation de la filière, les acteurs, leurs pratiques et performances, les contraintes au développement des activités, les interventions des institutions, les atouts et potentialités et les perspectives d’évolution de la filière. Cette analyse descriptive des données primaires et secondaires a facilité la conduite de l’analyse fonctionnelle qui détermine le rôle de chaque agent dans le fonctionnement de la chaîne agricole et permet de schématiser les flux qui s’y opèrent sous forme de cartographie.
Dans un deuxième lieu, une analyse financière basée sur le calcul des coûts, des marges nettes le long de la chaîne, des valeurs ajoutées et des bénéfices est également effectuée. S’agissant d’un projet de développement rural, plus particulièrement d’un projet de développement d’une filière agricole et donc un «projet à produit valorisable», nous utilisons dans l’analyse financière la méthode coûts-bénéfices. Cette analyse se base sur une description des différents flux qui s’opèrent le long de la chaîne de valeur, d’où la nécessité de recourir au préalable à l’analyse fonctionnelle. Après avoir dessiné la structure de la filière, nous pouvons passer au raisonnement en valeur monétaire et à la quantification des opérations observées.
Par le biais du tableur Excel, nous calculons ainsi le/la:
• Coût de revient d’un kilogramme de pomme de terre en estimant des coûts par opération, et ce, en se basant sur la fiches technico-économique dressée à partie des enquêtes sur terrains avec les producteurs:
Coût de revient = Coût d’achat + Coût de production + Coût hors production
Coût d’achat = Prix d’achat + Frais d’approvisionnement
Coût hors production = Charges d’emballage + Charges de publicité + autres charges
• Marge de bénéfice/ Kg et bénéfices pour chaque agent:
Marge bénéficiaire = Prix de vente – Coûts de revient
Bénéfice = Marge bénéficiaire * Quantité
• Valeur ajoutée pour les différents acteurs de la chaîne de valeur:
Valeur ajoutée = Chiffre d’affaires – Consommations intermédiaires
• Analyse coûts-bénéfices du système de culture:
Valeur actuelle nette (VAN):
VAN=Nt = 0 [(Bénéficest – Coûtst)] / (1 + r)t
Et Taux de rentabilité interne (TRI):
Nt = 0 [(Bénéficest – Coûtst )] / (1 + r)t = 0
Dans un dernier lieu, une analyse SWOT est dressée pour déceler les forces et les faiblesses qui caractérisent la filière pomme de terre, ainsi que les opportunités et les menaces que l’on devrait prendre en considération pour la proposition d’un plan d’action pour son développement. Les principaux axes d’intervention sont accompagnés à la fin par deux plans d’affaires pour des projets d’agrégation de la filière pomme de terre dans chacune des régions d’étude.
Résultats et discussion
Au Maroc, la production de pomme de terre est passée de 1 536 mille tonnes en 2008 à 1 743 en 2016 (Figure 1), une indication qui témoigne de la hausse de la demande des consommateurs. La filière regroupe aujourd’hui entre 50000 et 60000 petits et moyens agriculteurs en irrigué, avec des parcelles allant de 0,5 à 3 ha. La superficie dédiée à la pomme de terre au niveau national compte à peu près 60000 ha en 2016, et génère de 2 à 2,5 milliards de dirhams pour 20 millions de journées de travail. Stimulés par l’évolution des habitudes alimentaires et le niveau de l’offre sur les marchés nationaux, la consommation du tubercule atteint aujourd’hui 1,5 millions de tonnes environ.
Ces tendances se projettent également sur le plan régional. En effet, la production de pomme de terre a connu une augmentation significative depuis le début du PMV. En effet, entre la campagne 2009/2010 et 2016/2017, la superficie emblavée dans la région TTH est passée de 3 745 ha à 10 459 ha, avec une production passant respectivement de 76 à 258 mille tonnes. Cette dernière représentait 15% et 14%, respectivement, de la superficie et la production nationale de pomme de terre. En ce qui concerne la région du centre, après avoir connu une tendance haussière entre 2009 et 2013, la production a demeuré quasi stable sur la période 2013 à 2016 avec une production moyenne de l’ordre de 431 mille tonnes. Pour la région de TTH, près de 82% de la production se fait dans la province de Larache, qui relève du périmètre d’intervention de l’Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Loukkos. Pour la région de CS, elle connaît une concentration de la production dans les provinces de Berrechid et El Jadida, avec 45,6% et 25,5% comme parts respectives de la production régionale.
Les deux régions comptent plusieurs petites unités de stockage et de transformation de pomme de terre dont la capacité et le niveau d’activité sont pour la plupart méconnus en raison de leur caractère informel. Néanmoins, les investigations faites permettent de déduire qu’environ 10% de la production est valorisée en des produits tels que les chips et frites surgelées ou sous vides, mais les techniques d’emballage, de stockage et de conditionnement restent peu développées.
L’analyse descriptive des différents agents, de l’agriculteur au consommateur, et des flux qui les lient nous conduit à l’analyse fonctionnelle qui permet de définir la structure et le fonctionnement de la chaîne. Ainsi, nous avons pu tracer une cartographie de la chaîne de valeur de la pomme de terre (Figure 1). Nous retrouvons sur le marché la production nationale aux côtés de la pomme de terre importée. Les producteurs nationaux, regroupés parfois en coopératives, conduisent leurs tubercules soit directement vers le marché, soit vers la valorisation. Dans le premier cas, la production passe généralement par la participation des courtiers puis des grossistes, qui à leur tour approvisionnent les autres intermédiaires commerciaux. C’est un parcours classique où la marchandise passe par le marché de gros, principal lien entre la production et la vente en gros et les détaillants d’autre part. Une partie de la marchandise est livrée par les intermédiaires directement aux marchés hebdomadaires et aux souks, où elle est revendue par les détaillants, une autre partie se dirige vers les autres catégories à savoir: les vendeurs ambulants, les supermarchés, les GMS, etc. Dans le deuxième cas, la valorisation se fait soit par le stockage des tubercules, soit par transformation. Les unités frigorifiques reçoivent la production de la part des exploitants agricoles ou des coopératives. Les transformateurs de la pomme de terre en frites ou en chips se ravitaillent également auprès des agriculteurs mais aussi du marché international; et dans des cas assez fréquents en circuit informel, les transformateurs de pommes frites ont comme fournisseurs de matières premières les grossistes et les détaillants. Nous retrouvons au bout de la chaîne le consommateur final, qui, consommant aussi bien de la pomme de terre fraîche que les produits dérivés, a le choix de se ravitailler auprès de plusieurs acteurs notamment les GMS, les supermarchés, les détaillants, les grossistes, les vendeurs ambulants et les restaurateurs.
Pour chacun des agents illustrés sur la cartographie, le calcul des coûts de revient, des marges bénéficiaires, des bénéfices et des autres indicateurs aide dans la compréhension de la transmission de la valeur ajoutée le long de la chaîne de la pomme de terre dans les régions TTH et CS.
D’une part, l’analyse financière a révélé un total de charges supportées par le producteur de 63 000 Dh/Ha en moyenne. Les amortissements des équipements utilisés dans les différentes étapes de l’itinéraire ne sont pas pris en compte car il nous a été difficile de déterminer avec exactitude la valeur de certains matériels et moyens d’irrigations. Pour un rendement moyen de 40 T/ha, le coût de revient par kilogramme de pomme de terre affiche près de 1,6 Dh/kg. Pour la catégorie des intermédiaires commerciaux, le coût de revient le plus élevé est supporté par le détaillant avec 3,80 Dh/Kg. Ceci est expliqué par le nombre d’intermédiaires qui le précède et dont les charges s’accumulent au passage. Avec un coût de revient de 3,15 Dh/Kg, nous retrouvons en deuxième lieu le grossiste qui, en plus du prix d’achat, doit rémunérer ses travailleurs, les transporteurs et payer ses taxes. Le courtier et le vendeur ambulant ne supporte généralement comme charge supplémentaire que le transport. Le coût de revient moyen supporté le long de l’année par le transformateur de pommes de terre en pommes frites est de 5,5 Dh/Kg.
D’autre part, les observations montrent que la commercialisation de la pomme de terre est bénéficiaire à la catégorie «détaillant» en premier lieu, qui réalise le plus grand pourcentage de marge avec 24%. En effet, les détaillants sont libres d’appliquer les prix qu’ils souhaitent, et qui sont en général relatifs à l’emplacement géographique et/ou la présence ou non de concurrence. Dans la période où seules les pomme de terre stockées se retrouvent sur les marchés, les prix pour les consommateurs atteint jusqu’à 7 Dh/Kg. Les détaillants enquêtés justifient ces prix fluctuants par le risque qu’ils assurent en commercialisant un produit périssable. Situés à la fin de la chaîne de commercialisation, ils reçoivent des tubercules parfois endommagés à cause du transport et de la manutention, du stockage, ou autre. Confrontés également à des consommateurs de différents niveaux de préférence, les détaillants essaient au mieux de couvrir les pertes physiques subies.
En ce qui concerne les bénéfices, pour un rendement moyen de 40 T/ha, l’agriculteur destine le quart de sa production au stockage frigorifique et en vend les trois quarts. Avec une marge bénéficiaire de 0,35 Dh/Kg et une quantité de 30 T/ha, le producteur réalise un bénéfice de 10 500 Dh/an à l’hectare. Avec une marge bénéficiaire de 0,20 Dh/Kg en moyenne et une quantité moyenne de 6 T vendue par jour, les grossistes réalisent des bénéfices de 438 mille Dh/an. Les détaillants enquêtés avancent qu’ils s’approvisionnent en pomme de terre chaque deux jours. Ils achètent quatre caisses de 30 Kg en moyenne. Ceci leur permet d’assurer un écoulement total de leur marchandise et de garder une bonne qualité du produit. De ce fait, près de 22000 Kg de pomme de terre est vendu par an, avec une marge de bénéfice estimée à 1,20 Dh/Kg, résultat: 26400 Dh/an de bénéfice.
Le transformateur de pommes frites interrogé produit et écoule près de 1 T par jour. Pour une marge de 0,75 Dh/Kg, les bénéfices réalisés durant une année sont de 270000 Dh.
La valeur ajoutée brute est positive pour les quatre catégories d’acteurs. La plus grande richesse produite est concentrée au niveau du grossiste. Pour une meilleure interprétation de cet indicateur, nous calculons également le ratio VA/CA qui mesure la contribution de chaque maillon à la valeur de production. La plus grande valeur est de 0,24 et on la retrouve chez les détaillants (Tableau 1). Ce résultat s’aligne avec le raisonnement que nous avons eu pour la marge bénéficiaire de ce maillon.
En dressant une matrice SWOT, nous constatons que, en plus d’être un légume très convoité par le consommateur (1er légume avec environ 40 kg/hab/an en moyenne), la pomme de terre regorge d’un potentiel de développement important dans les deux régions avec le développement de l’irrigation localisée et l’amélioration des conduites culturales. La culture connaît également une évolution du rendement national et augmentation de la production avec un profil variétal important et diversifié.
Avec l’existence d’un important marché pour l’écoulement des produits de pomme de terre valorisée (frites, chips, etc.), les agriculteurs ont conscience de la nécessité de s’organiser en OPA pour répondre à la demande de pomme de terre au Maroc. Dans ce sens, L’État accorde pour les projets de développement des subventions et aides au secteur agricole.
L’analyse fait ressortir également les faiblesses de la filière pomme de terre que l’on peut résumer dans les capacités limitées des techniques agricoles des producteurs de pomme de terre, la dépendance de la filière des importations de semences, notamment celles à forte aptitude de valorisation, et leurs prix élevés (6 à 14 Dh/Kg), la faible utilisation des plants certifiés et le manque de diversification. Les difficultés de commercialisation que rencontrent les agriculteurs (Circuit de commercialisation non structuré avec un nombre important d’intermédiaires) en plus de la faible organisation de la filière et le manque d’infrastructure de stockage et de transformation forment un obstacle devant le développement de la filière.
Les opportunités que présente la filière sont principalement la forte croissante du marché international de la pomme de terre, avec notamment des possibilités d’exportation vers les marchés d’Afrique subsaharienne, et le développement du secteur de transformation au niveau national. Néanmoins, la culture reste encore menacée par les irrégularités des précipitations et la limitation des ressources en eau d’irrigation qui conditionnent l’accroissement de la production, notamment dans les zones de forte production. Nous citons également la concurrence des producteurs étrangers (l’UE et de l’Égypte en matière de produits transformés) et le changement des règles d’accès de produits agricoles marocains sur le marché européen.
À partir de l’analyse globale de la chaîne de valeur de la filière pomme de terre, nous sommes parvenu à proposer un plan d’action avec des interventions spécifiques pour permettre le développement de ladite filière. La feuille de route tracée en conséquence s’articule autour quatre axes. Le premier est le développement de l’amont agricole. Nous proposons deux actions, la première consiste à améliorer la productivité de la culture de la pomme de terre dans les deux régions étudiées et la seconde à l’amélioration de l’organisation de la filière. Le deuxième axe s’intéresse à l’aval de la filière, pour lequel nous proposons prioritairement de développer le secteur de stockage et de conditionnement du tubercule, et celui de la transformation. Le développement du marché intérieur et l’accroissement des exportations sont les actions qui définissent le troisième axe, celui de la commercialisation. Le quatrième et dernier axe agit dans le cadre de l’agrégation agricole, la première action est ainsi de promouvoir cette stratégie auprès des agriculteurs, la deuxième ambitionne de développer des projets d’agrégation.
Dans ce sens, nous proposons deux plans d’actions pour deux projets d’agrégation, un dans chacune des régions d’étude. De prime abord, vu le manque des structures de conservation frigorifique et le faible niveau d’absorption de la production régionale en pomme de terre par ses opérateurs, le projet d’une unité de stockage et de conditionnement dans chacune des régions nous a paru le plus pertinent. Or, dans la région du nord, l’ORMVAL a déjà prévu la réalisation d’une telle unité qui sera gérée par une coopérative. Nous avons donc pensé à la valorisation secondaire qu’est la transformation et avons proposé de mettre en place une unité de transformation de pommes frites. Pour la région du centre, nous avons gardé le raisonnement initial et avons évalué la faisabilité d’une unité de stockage et de conditionnement. L’étude financière a montré la viabilité et la rentabilité des deux projets proposés (VAN positives, et des TRI de 13,6 % et de 11,2% respectivement pour le projet de TTH et celui de CS).
Conclusion
En conclusion, il convient de dire que, malgré l’augmentation de production en pomme de terre, le problème de la qualité persiste et handicape les exportations de ce tubercule vers les marchés européens qui deviennent de plus en plus exigeants. Ce problème constitue un handicap pour la valorisation industrielle qui nécessite des variétés spécifiques. Pourtant, les opportunités qu’offre le secteur de la transformation industrielle sont importantes, surtout avec l’émergence et l’évolution de la restauration rapide et le changement des habitudes de consommation des ménages marocains.
La valorisation de la pomme de terre est une étape cruciale dans le développement de l’économie nationale, mais pour pouvoir développer des projets dans ce sens, il faut pallier aux contraintes qui se posent tout au long de la chaîne de valeur, de l’amont et de l’aval de la filière. L’agrégation agricole se définissant comme un partenariat gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval industriel, boite encore dans le cas de la filière étudiée. C’est pourquoi nous faisons des propositions palliatives aux contraintes détectées et que les parties prenantes pourraient prendre en considération dans leur vision du redressement de la situation de la pomme de terre au niveau national. Nous avons surtout mis l’accent sur l’organisation de la filière, l’amélioration de la productivité et de la performance du secteur, la relance des exportations et l’adaptation de l’offre à la demande nationale.
En effet, l’analyse globale de chaîne de valeur nous a permis d’avoir une vision claire de la façon d’amener un changement durable et systémique, d’où la proposition de deux projets d’agrégation. Étant conscient que dans différentes zones agricoles les producteurs ne disposent pas nécessairement des mêmes moyens de productions ni des mêmes conditions socio-économiques, nous avons opté pour un projet d’unité de stockage et de conservation pour la région du nord, et une unité de transformation de frites dans celle du centre pour permettre de baliser le terrain à des investisseurs agricoles.
En intégrant le maillon «producteur» dans ces modèles d’agrégation agricole, les projets contribueront à l’encadrement des agriculteurs (agrégés) par la diffusion des bonnes techniques de culture, des pratiques de récolte et de conservation, un approvisionnement en plants de qualité et un écoulement de la production certain, et surtout, une meilleure organisation de la filière. Cependant, il est indéniable que l’adhésion totale des agriculteurs, l’accompagnement des partenaires institutionnels et le renforcement des capacités techniques des organes de gestion (coopératives, personnel de l’unité, etc.), seront indispensables pour assurer la réalisation, le bon fonctionnement et la qualité des produits/services de ces activités.
Par Majid BENABDELLAH, Maram EL HARRAK
Département des Sciences Humaines, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc





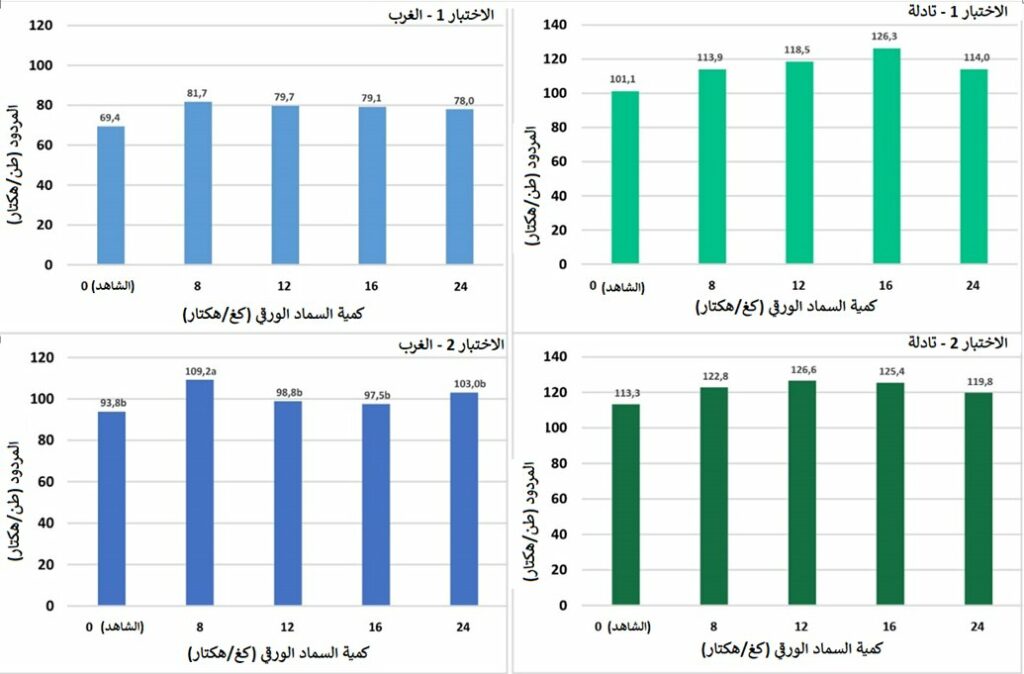


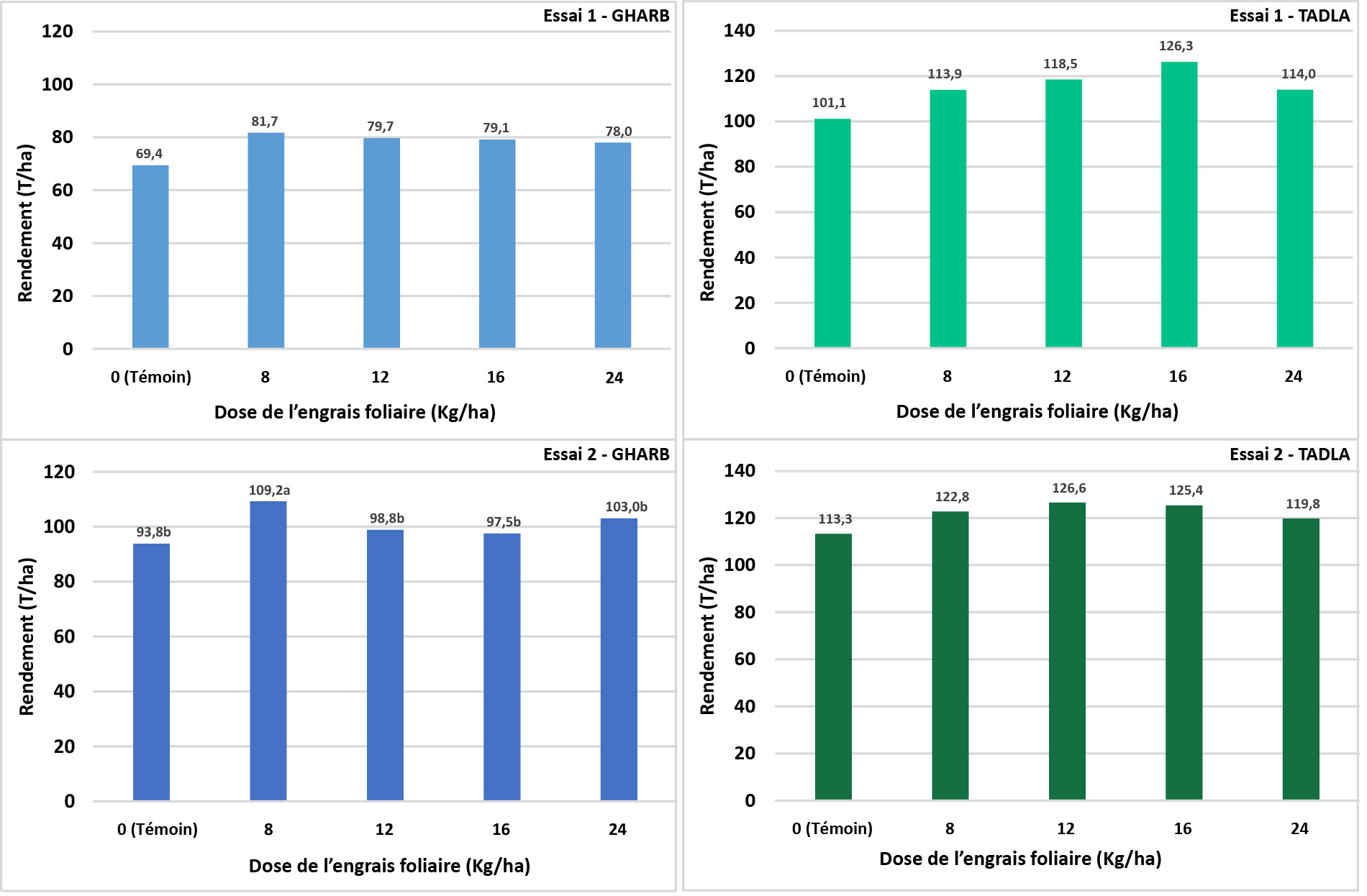
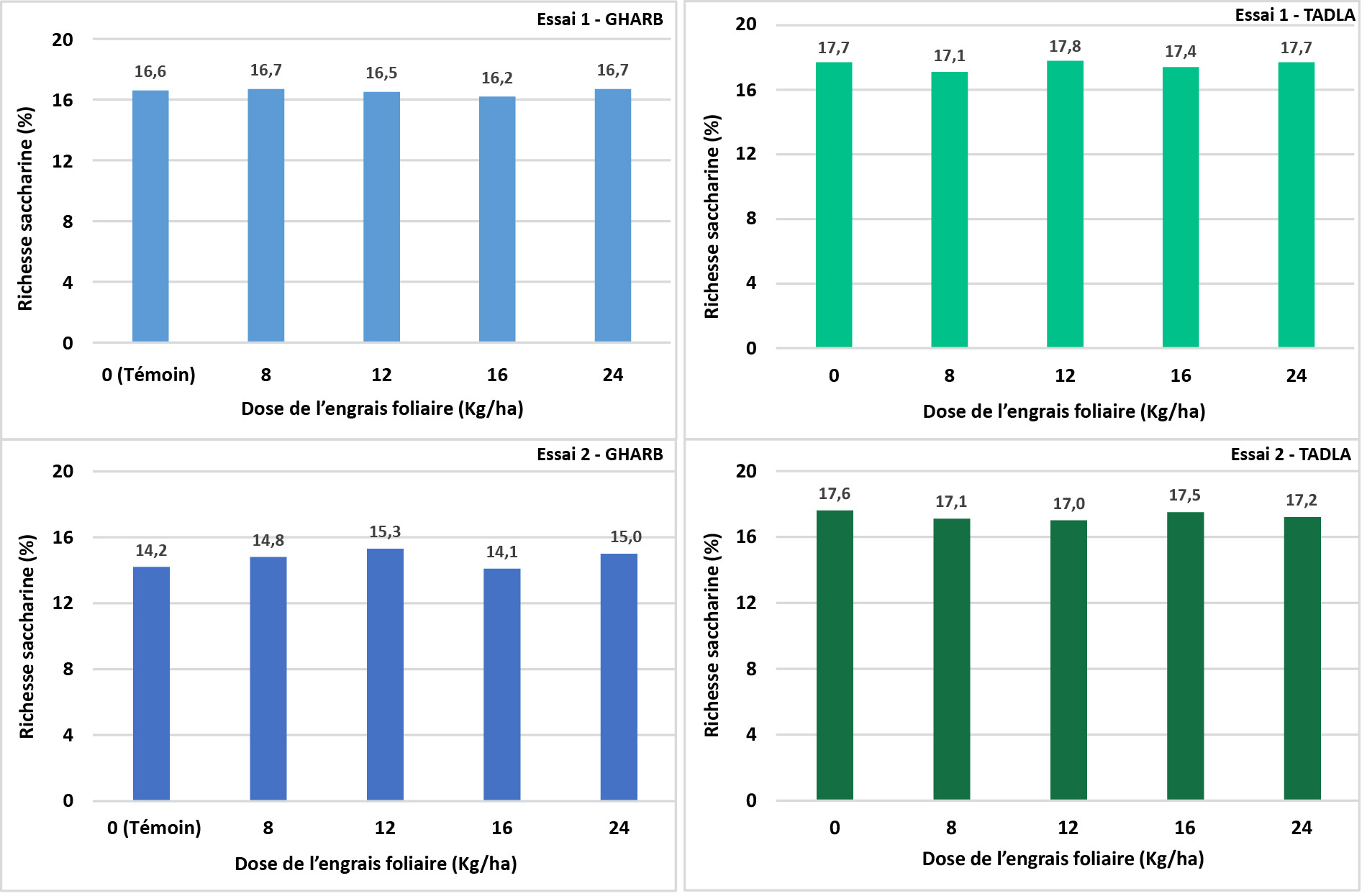
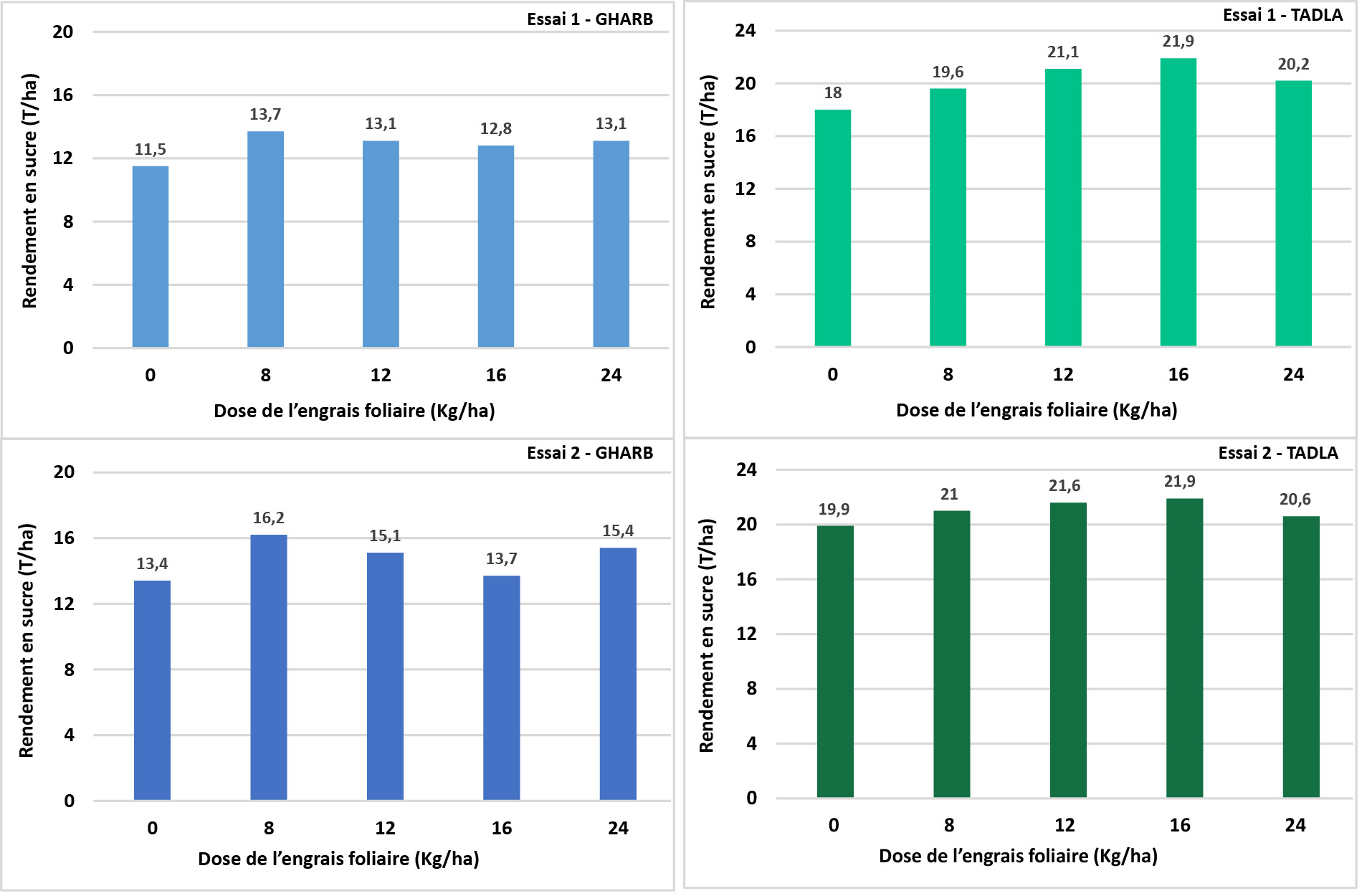
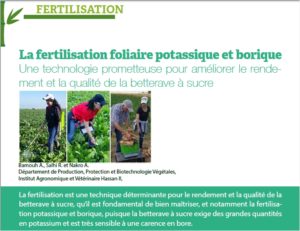 Télécharger
Télécharger