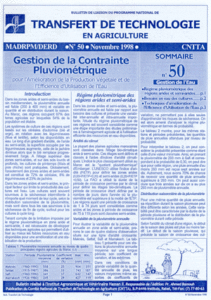Les principaux résultats de cette étude sur la rentabilité de ce type d’élevage laitier montrent que le revenu agricole moyen est de 147.000 dh par exploitation. La contribution de l’élevage est de 45%. La marge brute est de 1.415 dh par UGB bovine. Le taux de rentabilité est de 39% par rapport au chiffre d’affaires et de 30% par rapport au produit de l’élevage non compris la valeur du fumier. Cette rentabilité est influencée d’une part par les charges d’alimentation et les salaires qui représentent 93% des charges totales opérationnelles et d’autre part par la valeur du lait vendu, la moyenne économique (2.383 litres) et l’effectif des vaches laitières. La vente du lait représente la moitié du produit de l’élevage en ne prenant pas en compte le fumier. La contribution de la vente des animaux est de 33%. Cette dernière est liée à la conjoncture climatique. Le prix de revient du lait est de 2,02 dh par litre. Il est influencé par le coût de l’alimentation qui représente 77% des charges affectées au lait. La productivité des fourrages verts est inférieure au potentiel exprimé par les cultures pratiquées (100 T/ha pour la luzerne et le bersim). Le coût de l’unité fourragère varie entre 0,72 et 2,14 dh suivant l’espèce fourragère et sa productivité (28 à 55 T/ha). Le système végétal est caractérisé par la prédominance de l’arboriculture qui contribue à raison de 86% au revenu des cultures avec une moyenne de 89.000 dh par exploitation. Les céréales et les cultures maraîchères participent respectivement avec 12 et 2%, une partie de la production est destinée à l’autoconsommation, surtout pour les céréales.
Introduction
L’étude porte sur une vingtaine d’exploitations de taille moyenne situées dans le périmètre irrigué du N’Fis, couvert en grande partie par les plantations d’oliviers et situé à proximité de la ville de Marrakech. Il couvre une superficie d’environ 300 ha, soit 1,4% de la superficie agricole utile totale de ce périmètre. La superficie moyenne par exploitation est de 15 ha et la plupart des agriculteurs enquêtés possèdent entre 6 et 24 ha. Seules deux exploitations disposent d’une superficie supérieure à 30 ha. Les principaux statuts juridiques des terres sont le Melk et le Guich. Ce dernier domine dans les communes de Tnine Oudaya et de Tamesloht.
Les plantations occupent les deux tiers des superficies cultivées. Elles sont suivies des céréales et des fourrages avec respectivement 17 et 16%, le maraîchage couvre moins de 1% de ces superficies. Ces cultures sont principalement pratiquées en sous étage, en association avec les oliviers qui couvrent la moitié de la superficie arboricole, le reste est occupé par les abricotiers et les pommiers.
Les troupeaux sont composés en moyenne de 8 vaches laitières. Les valeurs extrêmes sont respectivement de 14 et de 5 têtes. 80% des éleveurs de l’échantillon possèdent entre 6 et 10 vaches. La structure génétique du troupeau est caractérisée par la prédominance des races améliorées avec 98% de l’effectif total (Pures: 62%; Croisées: 36%) contre 2% seulement pour la race locale.
Les bâtiments d’élevage sont plus ou moins adaptés aux conditions de la région. Ils sont dans la majorité des cas construits en pisé et en dur. Toutes les exploitations sont dotées d’au moins un puits, souvent équipé de motopompe (3 à 6 pouces). Ces puits sont destinés à un double usage: domestique et d’irrigation de complément. Les débits fournis se situent en moyenne entre 8 et 12 l/s.
La mécanisation des travaux agricoles est relativement avancée, à l’exception des petites exploitations (moins de 5 ha) qui forment 78% des unités de ce périmètre. Sur les vingt exploitations de l’échantillon, sept disposent d’un tracteur et de son matériel d’accompagnement (charrues à disques, cover crop). La majorité des agriculteurs louent des tracteurs auprès des particuliers à raison de 90 à 120 Dh par heure de travail effective. En revanche, la traction animale est particulièrement importante dans les petites et moyennes exploitations. Elle est utilisée dans le transport des fourrages verts ainsi que dans le binage.
Le mode de faire valoir direct est dominant. La conduite du troupeau et l’exploitation des fourrages est confiée à une même personne. Celle des cultures est attribuée à un membre de la famille. 60% des exploitations emploient un salarié permanent pour s’occuper de l’élevage.
Résultats techniques des élevages laitiers
Les données recueillies sur ces exploitations constituent seulement des ordres de grandeurs approximatifs, étant donné l’absence d’un système d’enregistrements des données (contrôle laitier). Elles permettent cependant d’en délimiter les grands traits.
Des élevages orientés vers la production laitière
La composition des troupeaux montre l’importance accordée à la production laitière. Le rapport entre le nombre de vaches laitières présentes et l’ensemble du cheptel bovin exprimés en UGB est de 72,4% (Tableau 1).
Tableau 1:Indicateurs de gestion des élevages laitiers (moyenne de l’échantillon)
| Critères |
|
Valeur |
CV% |
| Caractéristiques générales des exploitations |
Superficie totale
Sup. Fourragère
Nb d’ha année fourrage
Sup.fourrag/Sup totale (%)
Taux d’intensif. culturale |
14,9 2,7 1,8 20,0 118,0 |
5745462715 |
| Taille destroupeaux laitiers |
Nbre vaches présentes
UGBVL (vache laitière)
UGBB (bovin)
UGBVL/UGBB % |
8,0 17,8 24,4 72,4 |
31 38 35 10 |
| Critères de reproduction |
Age au 1er vêlage (mois)
Rang moy. de lactation
Taux de réforme
Taux de renouvellement
Taux de prolificité
Taux de mortalité veaux
Intervalle V-V (mois) |
30 à 40 4,2 13,0 9,0 96,0 14,0 14 à 16 |
– 15 81 107 9 80 – |
| Coût de l’alimentation en concentré |
Concentrés /VP/an (kg)
Coût concentrés/VP/an (Dh)
Lait économique (l)
Concentrés/litre de lait (kg)
Concentrés/litre de lait (Dh) |
1.177 2.474 1.608 0,5 1,0 |
25 30 22 19 17 |
| Critères de productivité |
Product annuelle de lait (l)
Moyenne économique (l) |
19.640 2.383 |
47 22 |
| Critères chargement des superficies fourragères |
Nb d’UGBB/SAU
Nb d’UGBB/HAF
Nb vaches présentes /HAF
Nb vaches présentes /SFP |
1,9 14,7 4,8 3,2 |
39302727 |
Les vaches laitières sont à leur la 4ème lactation, ce qui correspond à la phase où leur productivité est maximale. Cependant, l’âge au premier vêlage se situe entre 30 et 40 mois. Ceci montre que la composition des troupeaux est hétérogène du point de vue génétique.
Des taux de renouvellement et de réforme faibles et hétérogènes
L’analyse de la variation des effectifs des vaches laitières au cours de la campagne 1994-95 permet de faire un double constat: les taux de renouvellement et de réforme sont faibles d’une part et hétérogènes d’autre part. Le premier est en moyenne de 9% et le second de 13%. Ce dernier varie entre 0% et 41% (Tableau 1).
Les raisons invoquées par les agriculteurs pour la réforme des vaches laitières sont, en premier lieu, liées aux problèmes de reproduction des animaux, suivis de ceux de la production laitière et des disponibilités alimentaires. Ces problèmes sont fortement ressentis par les petits producteurs surtout en période de sécheresse, caractérisées par la flambée des prix des sous-produits (son de blé, pulpe sèche de betterave…).
Une fécondité et une mortalité des veaux peu maîtrisées
L’analyse des résultats de la reproduction montre l’existence de deux insuffisances:
L’intervalle entre vêlages est relativement long. Il est de 14 à 16 mois au lieu de 12 mois selon la norme optimale, soit la production d’un veau par vache et par an.
Le taux de mortalité est en moyenne de 14%. Il varie cependant entre 0 et 30%.
Seul, le taux de prolificité est satisfaisant. En moyenne, il est de 96%. Il traduit un bon déroulement des mises-bas chez la quasi-totalité des vaches laitières.
Une alimentation peu coûteuse, riche en fourrage et pauvre en concentrés
L’alimentation est basée sur l’utilisation des aliments grossiers. Ces derniers représentent 59% des apports énergétiques et 60% des charges d’alimentation. Les niveaux des chargements sont peu élevés en raison notamment de la faiblesse de la productivité des cultures fourragères. Trois aliments assurent l’essentiel de la ration de base: la luzerne, le bersim et la paille. Les fourrages de récupération comprennent les mauvaises herbes des céréales, celles qui poussent sous les arbres fruitiers et les chaumes. Ils sont pâturés par les animaux de trait. La paille mélassée est rarement utilisée. Les aliments concentrés sont composés du son de blé, de la pulpe sèche de betterave et occasionnellement des aliments composés.
La superficie moyenne occupée par les cultures fourragères est d’environ 2,7 ha par exploitation. La luzerne s’étend sur 1,4 ha, soit 54% de la superficie fourragère. Généralement, les fourrages sont distribués en vert. Cependant, certains producteurs déclarent qu’en bonne année climatique, une partie de la production des luzernières est utilisée sous forme de foin en période de soudure. Cette phase se situe entre novembre et février.
L’exploitation de la luzerne dure 10,5 mois et s’étend du milieu du mois de février à la fin de novembre. Le nombre de coupes dépasse souvent 8. Le bersim est coupé 5 fois par an. Il est récolté entre le milieu de novembre et la première décade du mois de mai. La distribution de la paille se fait tout au long de l’année en tant qu’aliment grossier ou en tant que litière. Sa contribution dans l’alimentation est importante en hiver.
Les niveaux de chargements sont moins denses que ceux qui sont pratiqués dans les élevages laitiers les plus intensifs. La stratégie adoptée par les éleveurs consiste à réguler la taille du troupeau en fonction du niveau de productivité des cultures fourragères afin de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires au moindre coût, notamment en réduisant les achats d’aliments concentrés. Les chargements les plus faibles (0,64 à 1,33 UGBB/SAU) sont observés dans les exploitations dont une partie importante de la superficie fourragère est conduite en sous-étage.
Consommation de fourrages
Les quantités respectives de paille et de fourrages verts distribuées aux vaches laitières sont de 2 et 10,7 tonnes par vache présente (Tableau 2), soit l’équivalent de 5,5 kg de paille et de 29 kg de fourrages verts par jour et par vache présente. Les apports quotidiens peuvent varier, suivant les périodes, les exploitations et leurs disponibilités dans une fourchette qui va de 10 à 40 kg de bersim et de luzerne et de 4 à 8 kg de paille.
Tableau 2:Contribution des fourrages dans l’alimentation
| Critères |
Moyenne |
CV% |
Valeur minimale |
Valeur maximale |
Valeur médiane |
Critères de
chargement |
UGBB/SAU
UGBB/HAF
VP/HAF
VP/SFP |
1,914,84,83,2 |
39302727 |
0,65,81,91,3 |
3,324,78,45,0 |
1,715,24,83,1 |
| Aliments grossiers/VP/an |
Paille (en kg) Four. verts (T) |
199310,7 |
2517 |
15258,0 |
365014,0 |
183210,8 |
| Apports annuelsen UF des aliments grossiers par VP |
UFL:Fourrages
UF paille
Total (P+FV) |
12683591627 |
172411 |
8282741288 |
16786571998 |
12873301657 |
| Total UF |
UFALG/UFT % |
59 |
12 |
46 |
70 |
60 |
Les apports énergétiques sont en moyenne de 1.268 UF par vache présente et par an pour les fourrages et de 360 UF pour la paille. Ce qui constitue respectivement 46% et 13% de l’énergie totale. L’importance des apports énergétiques d’origine fourragère s’explique par le souci des éleveurs d’être le moins dépendants possible du marché des aliments concentrés, en raison des fortes fluctuations des prix en période de pénurie.
Le coût des fourrages verts représente 29% des charges totales d’alimentation. Il s’élève à 1573 Dh par vache présente. Le coût de la paille est du même ordre de grandeur. Le coût de l’alimentation fourragère varie cependant fortement d’une étable à une autre. Il fluctue entre 745 Dh et 2.990 Dh. Cet écart s’explique à son tour par la variabilité des superficies fourragères (de 1,5 à 5 ha) et par celle des rendements des cultures (entre 35 et 53,5 T/ha).
La consommation des aliments concentrés
Les aliments concentrés (son de blé et pulpe sèche de betterave) servent à combler, en partie, le déficit alimentaire souvent observé durant la période hivernale (décembre-janvier). Pour la majorité des exploitations laitières, la pulpe sèche de betterave sert rarement à compléter la ration en été. Les aliments composés sont surtout utilisés dans le cadre des actions étatiques de sauvegarde du cheptel en année de sécheresse. Cependant, les dotations reçues par chacune des exploitations enquêtées sont relativement faibles et ne dépassent guère 5 à 6 qx.
En moyenne, chaque exploitation enquêtée utilise annuellement une dizaine de tonnes d’aliments concentrés soit un peu plus d’une tonne par vache présente ou près d’un millier d’unités fourragères par tête. Bien que ces moyennes cachent en fait une grande variabilité, cette consommation ne représente que la moitié de celle observée dans élevages les plus intensifs dans la même région. Elle se traduit par un coût inférieur par rapport à ces mêmes élevages. En moyenne, ce coût est de 2.474 Dh par vache (Tableau 1). Toutefois, le coût de l’unité fourragère est relativement élevé dans ces élevages non contrôlés. Il est de 2,20 Dh/UF contre respectivement 1,66 et 1,87 Dh/UF dans le cas des élevages pépiniéristes dans le Haouz et dans le Gharb. Cette différence peut être attribuée à la nature et à aux fluctuations des prix de ces aliments.
La quantité de concentrés consommés par litre de lait est également inférieure à celle enregistrée dans les élevages intensifs. Elle est de 0,5 kg soit un apport énergétique de 0,47 unités fourragères par litre de lait. Cet apport permet de satisfaire les besoins énergétiques nécessaires à la production d’un litre de lait avec un léger dépassement de 0,04 Ufcc/litre en supposant que les besoins d’entretien de la vache sont totalement couverts par la ration de base.
Le coût de cette alimentation est en moyenne de 1,01 Dh par litre de lait produit. Il représente 45% environ du coût alimentaire total contre 55% pour les aliments grossiers, soit 1,22 Dh par litre de lait produit. Il est du même ordre de grandeur que celui des élevages intensifs. Cependant, les valeurs extrêmes sont respectivement de 0,69 et 1,37 Dh par litre. L’ampleur de cet écart entre la valeur minimale et la valeur maximale s’explique par une mauvaise utilisation des aliments concentrés. La productivité par vache de l’exploitation qui dépense le plus en concentrés est de 2.301 litres. Elle est très proche de celle dont les dépenses sont les plus faibles (2.189 litres/1.506 Dh). La première dépense 3148 Dh alors que la seconde dépense deux fois moins. L’écart entre ces charges s’explique par une mauvaise valorisation des concentrés par les vaches laitières de la première exploitation due à une mauvaise adéquation entre les besoins et les apports selon les stades de lactation. Il reflète également le faible potentiel de production des animaux de cet élevage. Il correspond également à une ration alimentaire déséquilibrée (excès d’énergie par rapport aux MAD). Il est aussi le résultat de ruptures répétées en concentrés. Un renforcement des dotations distribuées après chaque cessation ne donne pas forcement lieu à une augmentation de la production dans l’immédiat, et encore moins à une compensation des pertes antérieures engendrées par les ruptures d’approvisionnement.
Une productivité insuffisante et hétérogène
D’une manière globale, la productivité des vaches laitières est insuffisante, compte tenu des opportunités offertes par le milieu (périmètre irrigué, proximité de la zone urbaine) et du potentiel du troupeau bovin exploité (98 % des vaches sont de race améliorée). Pourtant, la production du lait améliore le revenu global puisqu’elle représente 45% du revenu agricole et constitue une source de recettes régulières le long de l’année. Les recettes sont utilisées pour faire face aux achats d’aliments du bétail, aux dépenses des cultures et pour couvrir les besoins de la famille.
La production annuelle moyenne est de 20000 litres avec un écart élevé entre les valeurs extrêmes (Tableau 3). Celui-ci s’explique par les différences dans la taille et la composition des troupeaux, par des apports inégaux en aliments concentrés et par conséquent par des productivités différenciées. Le rendement en lait par vache présente de l’exploitation la plus performante est le double de celle qui est la moins efficiente.
Tableau 3: Indicateurs de productivité (en litre)
| Indicateurs de productivité |
Moyenne échantillon |
CV en % |
Valeur minimale |
Valeur maximale |
Valeur médiane |
| Production par étable |
19.641 |
47 |
8.694 |
43.078 |
18.074 |
| Moyenne économique |
2.383 |
22 |
1.450 |
3.572 |
2.397 |
| Dépenses en concentrés en équivalent lait |
775 |
29 |
490 |
1.353 |
768 |
| Lait économique |
1.608 |
22 |
926 |
2.218 |
1630 |
La production moyenne par vache présente de 2.400 litres. La valeur maximale est de 3.572 litres contre 1.450 litres pour la valeur minimale. La quantité moyenne du lait économique par vache présente est de 1.600 litres, avec une faible dispersion autour de cette moyenne (Tableau 3).
Rentabilité des élevages laitiers
L’étude de la rentabilité repose sur l’analyse des charges, des produits et des marges brutes par exploitation et par vache présente. Trois niveaux de marges ont été définis séparément: la marge brute lait, la marge brute de la production animale et la marge brute globale de l’élevage. La première correspond à la valeur du produit lait diminuée des charges variables liées à l’alimentation et à la main d’œuvre du sous atelier «vaches laitières». Le but étant d’effectuer une analyse isolée du «produit lait». La deuxième représente la différence entre la valeur de l’ensemble des produits des élevages laitiers, non compris le fumier, et des charges totales de l’élevage. Ce niveau de marge a été défini dans le but de comparer les résultats de ce travail avec ceux obtenus dans d’autres régions et dans lesquels le produit fumier n’a pas été pris en considération. La troisième marge tient compte de la totalité des charges et des produits des élevages laitiers y compris le fumier.
Les charges
Les charges variables moyennes par exploitation s’élèvent à 77000 Dh et à 9600 Dh par vache. L’alimentation absorbe 82% des charges opérationnelles, la main d’œuvre 16% (Tableau 4). La rentabilité du système laitier dépend par conséquent de la manière dont sont gérés ces deux postes. Les soins vétérinaires et les frais de l’insémination artificielle sont négligeables. Ils connaissent cependant la dispersion la plus forte.
Tableau 4: Produits et charges des élevages laitiers (moyenne par exploitation, par UGB et par vache)
|
par exploitation |
par UGB |
par vache |
| En Dh |
En% |
CV% |
En Dh |
En Dh |
| PRODUITS |
|
|
|
|
|
| Ventes de lait |
49.757 |
38 |
52 |
1.981 |
5.951 |
| Ventes animaux |
36.063 |
27 |
43 |
1.510 |
4.551 |
| Fumier |
23.448 |
18 |
37 |
965 |
2.910 |
| Naissances |
13.500 |
10 |
43 |
560 |
1.688 |
| Lait autoconsommé |
4.202 |
3 |
28 |
178 |
535 |
| Cessions internes |
5.586 |
4 |
37 |
233 |
703 |
| Produit total |
132.556 |
100 |
39 |
5.427 |
16.338 |
| CHARGES |
|
|
|
|
|
| Concentrés |
23.433 |
30 |
51 |
931 |
2.830 |
| Paille |
18.803 |
24 |
27 |
800 |
2.435 |
| Fourrages |
16.738 |
22 |
65 |
666 |
2.007 |
| Salaires |
11.588 |
15 |
35 |
501 |
1.514 |
| Lait distribué aux veaux |
5.586 |
7 |
37 |
233 |
703 |
| Transport |
550 |
1 |
38 |
24 |
72 |
| I.A. |
161 |
0,2 |
143 |
6 |
20 |
| Soins |
199 |
0,3 |
169 |
6 |
25 |
| Charges totales |
77.058 |
100 |
|
3.167 |
9.606 |
| Marge brute totale |
55.498 |
|
|
2.260 |
6.730 |
| Marge brute lait |
7.368 |
|
|
250 |
746 |
| Produit lait viande |
109.108 |
|
|
4.462 |
13.428 |
Les charges d’alimentation comprennent les dépenses en concentrés, le coût de production des cultures fourragères et la valeur de la paille achetée ou produite sur l’exploitation. Les concentrés représentent le tiers des charges de l’élevage. La paille et les fourrages revêtent la même importance. Ils occupent chacun le quart de ces charges.
Les charges dues à l’utilisation de la main d’œuvre sont en moyenne de 11.600 Dh par exploitation et de 1500 Dh par vache. La majeure partie des éleveurs n’emploie qu’un seul ouvrier pour conduire à la fois le troupeau bovin (8 têtes en moyenne) et s’occuper des cultures fourragères.
Les charges dues à l’allaitement des veaux par leur mère sont en moyenne de 5600 Dh par étable et de 700 Dh par vache présente, ce qui représente un manque à gagner non négligeable. Les charges de transport des animaux achetés ou vendus, du lait et des aliments achetés sont de 500 Dh par exploitation.
Les produits
Le produit total de l’élevage comprend les recettes de la vente du lait et des animaux ainsi que la valeur des veaux et de celle du fumier. La variation de la valeur des effectifs n’a pas été prise en considération dans l’évaluation du produit total de l’élevage, en raison de l’absence d’informations précises concernant la valeur du cheptel entre le début et la fin de la campagne et en particulier celles relatives au poids des animaux.
Les recettes provenant de la vente du lait représentent près de 40% du produit brut de l’élevage. Elles sont en moyenne de 50000 Dh par exploitation et de 6000 Dh par vache (Tableau 4). Elles constituent une source de trésorerie régulière et essentielle pour le financement des achats d’aliments concentrés, de certains intrants et la satisfaction des besoins de la famille.
Les ventes d’animaux contribuent pour un plus du quart dans le produit total de l’élevage avec une moyenne de 36.000 Dh et une recette de 4500 Dh par vache. Elles concernent les vaches de réforme, souvent de race locale en vue d’introduire des races améliorées, et les jeunes animaux issus de l’élevage des veaux nés sur l’exploitation. Ces derniers se nourrissent essentiellement de la paille et des mauvaises herbes prélevées sur les champs de culture et des plantations, ce qui est loin de leur assurer une alimentation équilibrée adaptée aux besoins de leur engraissement.
Les ventes d’animaux sont destinées à couvrir les achats d’aliments de bétail surtout en en période de sécheresse ainsi qu’à financer les frais des cultures. Elles permettent également d’éviter de recourir à des emprunts bancaires jugés onéreux par les producteurs.
En moyenne, la valeur du fumier est estimée à 23000 Dh par exploitation et à 2900 Dh par vache, ce qui représente 18% du produit total de l’élevage. L’importance de ce produit vient de l’augmentation de son prix qui est passé en quelques années de moins 50 Dh à plus de 150 Dh la tonne dans la région. Cette évolution résulte de l’extension de l’arboriculture, des cultures en sous étage et de l’introduction de certaines cultures maraîchères très exigeantes en fumier organique telle que la pomme de terre. La valeur du fumier est estimée sur la base des normes avancées par Mazouz relatives Les quantités de fumier produites dépendent du mode de stabulation et de la catégorie des animaux.
La valeur des naissances est en moyenne de 13500 Dh par exploitation et de 1700 Dh par vache, ce qui représente 10% du produit total de l’élevage. Elle est évaluée sur la base des prix recueillis lors des enquêtes relatives aux prix des veaux. Ces derniers varient suivant la race, l’état et la conformation de l’animal. Le prix d’un veau de race locale varie dans une fourchette de 1.000 à 1.500 Dh, celui d’une race croisée entre 2.000 et 2.500 Dh, alors que celui d’un veau de race pure oscille dans un intervalle allant de 2.000 à 3.000 Dh.
La faiblesse de ce produit s’explique par un taux élevé de mortalité des veaux (16%) et par un long intervalle entre les vêlages (14 à 16 mois). De ce fait, le nombre des naissances est faible. Il est en moyenne de 5,5 veaux par étable pour un effectif de 8 vaches présentes, ce qui signifie que 30% des vaches n’ont pas vêlé durant la campagne agricole étudiée. Comparée à l’optimum technique – un veau par an et par vache – cette situation engendre des manques à gagner qui varient entre 2.500 et 7.500 Dh par exploitation selon qu’il s’agit des veaux de race locale, croisée ou pure. L’autoconsommation est évaluée à raison de 4.200 Dhs par famille sur la base de 3 Dh le litre.
Marges brutes
Marge brute lait
L’analyse des trois niveaux successifs de marges brutes a montré que la vente du lait est incapable à elle seule de permettre de dégager une rentabilité suffisante. Elle est complétée par la présentation des ratios de rentabilité. Ces derniers sont au nombre de deux: le premier met en rapport la marge brute avec le chiffre d’affaires, représenté par la valeur des ventes du lait et des animaux durant la campagne observée. Le deuxième correspond à la marge brute rapportée au produit brut.
La production laitière est insuffisante à elle seule pour procurer au producteur un niveau de marge satisfaisant en particulier dans les élevages à faible productivité (Tableau 4). En moyenne la marge brute par vache est de 730 Dh. Le coefficient de variation de cette dernière est relativement élevé (cv=169). Il dénote d’une grande variabilité dans la rentabilité des élevages étudiés. La marge la plus forte est de 3086 Dh par vache contre une perte de 1776 Dh pour l’exploitation la moins rentable. Sur les 20 élevages de l’échantillon, 6 enregistrent des marges brutes lait négatives. Ils se caractérisent à la fois par un faible rendement laitier et par un coût élevé des aliments concentrés par litre de lait. Leur moyenne économique est proche de 2.000 litres par vache. Au-delà de ce seuil de productivité, toutes les exploitations ont pu obtenir des «marges brutes lait» positives. Ainsi, il existe une relation étroite entre cette marge et la moyenne économique.
En outre, le coût des concentrés par litre de lait dans les élevages les moins productifs est compris entre 0,47 et 0,70 Dh. Il est plus faible dans les autres élevages. Les exploitations concernées présentent par conséquent un problème d’alimentation lié à une mauvaise valorisation des concentrés.
Marges brutes lait viande et marges brutes totale de l’élevage
En tenant compte de tous les produits de l’élevage à l’exception du fumier, la marge brute moyenne passe de 730 Dh à 3117 Dh par vache et de 302 à 1262 Dh par UGB bovine. Il est à remarquer qu’en moyenne la rentabilité des élevages non contrôlés est proche de celle des élevages pépiniéristes du Gharb (Boubkri,1995). Elle est cependant inférieure à celle observée dans les Doukkala avec 2.814 Dh/UGBB (Dahmane,1993). Par contre, elle est supérieure à celles des élevages du même types pratiqués dans les régions des Doukkala où elle est de 743 Dh/UGBB et dans le Tadla 1.020 Dh/UGBB (Kendadi,1992).
La marge brute s’améliore en incluant la valeur du fumier dans celle du produit brut. Elle est le double de la précédente avec 50000 Dh par exploitation et 6000 Dh par vache (Tableau 4).
Analyse des ratios de rentabilité
la rentabilité de l’élevage laitier est satisfaisante. Ainsi, en ne tenant pas compte de la valeur du fumier, en moyenne la part de la marge brute est de 39 % du chiffre d’affaires et de 30 % du produit brut d’élevage. Cette rentabilité est légèrement supérieure à celle des élevages pépiniéristes dans le Gharb, avec respectivement 33 % et 28%. Cette légère supériorité s’explique par l’importance de la valeur des ventes d’animaux qui augmente en année de sécheresse (comme ce fut le cas de la campagne 1994-95) pour faire face à la hausse des prix des aliments de bétail. En incluant le fumier, la part de la marge brute est de 68% du chiffre d’affaires et de 41% du produit total élevage.
Prix de revient du lait
Le prix de revient du lait dépend de la nature de la campagne agricole dans laquelle il a été étudié. La conjoncture climatique de 1994-95 s’est traduite par des ventes importantes d’animaux dont les entrées d’argent ont servi à sauvegarder le cheptel gardé sur l’exploitation, en lui assurant un approvisionnement en paille et en aliments concentrés.
Les coûts totaux affectés à la production du lait sont en moyenne de 4 Dh par litre (Tableau 5). Les charges d’alimentation et de main d’œuvre constituent à elles seules près de 94% des charges affectées au lait dont 47% pour les aliments grossiers 30% pour des concentrés. En déduisant la valeur des sous-produits de ces coûts, le prix de revient du litre n’est plus que de 2,02 Dh. Les charges d’amortissement relatives aux bâtiments n’ont pas été comptabilisées, car il s’agit souvent d’anciens locaux aménagés.
Tableau 5: Prix de revient par litre de lait
| Charges affectées au lait |
En Dh |
En % |
CV % |
Fourrages verts
Paille
Concentrés
Main d’oeuvre
Autres charges (transport, IA, soins) |
0,821,101,190,680,22 |
202730176 |
2943134380 |
| Charges totales |
4 |
100 |
18 |
| Sous-produits (ventes animaux) |
1,98 |
100 |
42 |
| Prix de revient |
2,02 |
|
|
La comparaison du prix de revient avec le prix offert par la coopérative (3,07 Dh/l) montre que les producteurs dégagent un gain qui varie de 0,72 Dh/l en haute lactation à 1,22 Dh en basse lactation.
Analyse de groupe
L’analyse de groupe suppose une homogénéité des conditions naturelles, des ressources utilisées et des systèmes de production. Elle n’exige pas par contre une uniformité dans l’utilisation des facteurs variables (intrants, main d’œuvre). Cette analyse a porté sur un groupe homogène d’exploitations situées dans le périmètre N’Fis (rive droite) et dotées d’appareils de production plus ou moins similaires. Il s’agit d’exploitations de polyculture élevage dont la superficie varie de 5 à 40 ha, dont la taille des troupeaux laitiers est comprise entre 5 et 15 têtes composées en grande partie de vaches de races croisée ou pure et cultivant entre 0,2 et 0,5 ha de fourrages par vache.
Ces exploitations ont été classées en trois groupes selon le niveau de marge brute globale de la production animale par unité de Gros Bétail bovine. Le premier est un groupe de tête constitué de 5 exploitations. La marge brute réalisée oscille dans une fourchette qui va de 2.885 à 3.635 Dh/UGBB avec une moyenne de 3.088 Dh. Le deuxième est un groupe intermédiaire formé de 10 exploitations. Il a pu obtenir un niveau de marge brute moyen de l’ordre de 2.350 Dh/UGBB, les valeurs extrêmes correspondantes sont respectivement de 2.044 et 2.638 Dh. Le dernier est le groupe de queue. Il est composé de 5 exploitations dont la marge brute varie entre 972 et 1.962 Dh/UGBB avec une moyenne de 1.570 Dh (Tableau 6).
Tableau 6: principaux produits et charges des élevages laitiers par groupe (en Dh/UGBB)
|
G. detête |
G. dequeue |
G.inter-méd. |
Ecart entre G.extrêmes |
Moyenne de l’échantillon |
| PRODUITS |
|
|
|
|
|
| Ventes lait (1) |
2.644 |
1.379 |
2.038 |
1.265 |
1.981 |
| Ventes animaux (2) |
2.025 |
1.333 |
1.434 |
692 |
1.510 |
| Total (1) +(2) |
4.669 |
2.712 |
3.472 |
1.957 |
3.491 |
| Produit brut |
6.511 |
4.333 |
5.405 |
2.178 |
5.427 |
| CHARGES |
|
|
|
|
|
| Aliments concentrés |
1.106 |
715 |
952 |
391 |
931 |
| Fourrages verts |
855 |
533 |
638 |
322 |
666 |
| Paille |
783 |
864 |
779 |
-81 |
800 |
| Charges totales l’alimentation |
2.744 |
2.112 |
2.369 |
632 |
2.397 |
| Charges totales |
3.423 |
2.763 |
3.055 |
660 |
3.167 |
| Marges brutes |
3.088 |
1.570 |
2.350 |
1.518 |
2.260 |
Cette classification permet de dégager des normes clés à partir des résultats du groupe de tête et de mettre en relief les déficiences du groupe de queue ainsi que les marges de progrès dont il dispose. L’analyse des indicateurs technico-économiques de gestion des troupeaux permet de faire ressortir ces normes.
Facteurs de différentiation de la productivité des élevages laitiers
La capacité de production du groupe de tête est très proche de celles des autres groupes. L’écart entre les groupes extrêmes en termes de superficies cultivées est de 7 ha et de seulement d’un ha au niveau des superficies fourragères. La taille des troupeaux laitiers et leur composition (part des races locales) est quasiment la même pour les trois groupes. Pourtant, le volume de la production et la productivité des vaches laitières du premier groupe représentent le double de ceux du groupe de queue. Certes, la taille du troupeau laitier de ce dernier est de 6,45 vaches contre 8,1 vaches pour le groupe de tête (Tableau 7). Cet écart de 1,65 vache engendre une différence de production de 3.036 litres. Cependant, c’est la disparité en termes de productivité qui différencie le plus ces deux ensembles. La moyenne économique du premier dépasse de 1000 litres celle du groupe de queue. Elle est respectivement de 2.849 litres et de 1840 litres. Elle est à l’origine d’un écart de production d’environ 8.200 litres par exploitation. Le «lait économique» distingue également ces deux groupes. Celui du premier est de 1951 litres contre 1245 pour le dernier groupe, soit un écart de 706 litres par vache. Cet indicateur reflète à la fois un degré d’intensification plus élevé et une meilleure valorisation des aliments concentrés par les troupeaux laitiers du premier groupe. Celui-ci achète plus d’aliments concentrés que le dernier. Il distribue 1284 kg par vache contre 939 pour le groupe de queue. Cependant en raison de la faiblesse de la productivité des vaches du dernier groupe, il doit utiliser 0,52 kg de concentrés pour produire un litre de lait, contre seulement 0,45 kg par le groupe de tête.
Tableau 7: Tableau comparatif des indicateurs technico-économiques de gestion
| Indicateurs |
Unité |
Critères |
G. tête |
G. queue |
G. inter-méd |
Ecart G. extr. |
Moy. échan-tillon |
| Dimension |
ha
ha
VL
%
UGB
litre |
SAU
SFP
nb.VL
%RL
UGBB
prd.lait |
18,73,28,10,224,523.171 |
11,62,06,48,019,711.926 |
14,62,88,73,826,621.825 |
+7,1+1,2+1,6-7,2+4,811.245 |
14,92,78,02,024,419.640 |
| Reproduction |
Année
%
% |
RML
T.Réforme
Tx.mortalité veaux |
3,7189 |
4,8917 |
4,11214 |
-1,1+9-8 |
4,21314 |
| Chargement des superficies fourragères |
T/ha
nb
nb
nb/ha |
Rdt fourrages
VL/HAF
UGBB/HAF
VL/SFP |
45,74,814,62,98 |
35,55,115,33,17 |
43,74,714,63,36 |
+10,0-0,3-0,8-0,19 |
42,24,814,83,20 |
| Productivité |
litre
litre
kg
kg/l |
Rendement/VP
Lait écon/VP
Qté cc/VP
Qté cc/l |
2.8491.9511.2840,45 |
1.8401.2459390,52 |
2.4221.6181.2430,52 |
+1.009+706+345-0,07 |
2.3831.6081.1770,50 |
| Coûts de production |
Dh/VP
Dh/l
Dh/l |
Concentrés/VP
Concentrés/l
Prix revient lait |
2.7560,951,42 |
1.8251,002,68 |
2.4501,002,00 |
+931-0,05-1,26 |
2.4741,012,02 |
La faiblesse de la productivité des vaches du dernier groupe s’explique également par un chargement plus élevé des superficies fourragères et par des rendements insuffisants de son système fourrager. Elle est le résultat d’une inadéquation entre la taille du troupeau bovin et les disponibilités en fourrages verts. En effet, le groupe de queue dispose de 5 vaches par hectare année fourrage contre 4,8 vaches pour le groupe de tête. Il produit 35,5 tonnes de matière verte par hectare contre 45,7 tonnes par le groupe de tête.
La faible rentabilité des élevages laitiers du dernier groupe est due également à un taux de mortalité des veaux particulièrement élevé: 17% contre 9% seulement pour le groupe de tête. Ce résultat traduit une mauvaise gestion en termes de prophylaxie et de soins apportés aux animaux, en particulier les jeunes.
L’âge moyen des vaches en lactation est relativement bas dans le groupe de tête (3,7 années contre 4,7 dans le groupe de queue). Il s’explique en partie par l’introduction de nouvelles races améliorées au détriment de la race locale qui ne dépasse pas 0,2% des effectifs bovins. Son taux de réforme des animaux est deux fois plus élevé que celui du groupe de queue. Cependant, il est à souligner que la réforme des animaux dépend étroitement de la conjoncture climatique et par conséquent de la trésorerie disponible pour faire face aux besoins d’alimentation des troupeaux (achats de paille et de concentrés). Il en résulte que les taux obtenus par chacun des trois groupes sont à considérer avec prudence, car il ne s’agit probablement pas de décisions stratégiques mais plutôt tactiques.
Facteurs de différentiation de la rentabilité des élevages laitiers
Le groupe de tête est le plus compétitif. Il obtient le prix revient du lait le plus bas. Celui-ci est seulement 1,42 Dh contre 2,68 Dh pour le groupe de queue. En haute lactation, les gains du premier groupe sont de 1,32 Dh par litre alors que le groupe de queue couvre à peine ses coûts de production. En basse lactation les gains sont respectivement de 1,82 Dh et de 0,56 Dh.
Les recettes du lait du premier groupe représentent le double de celles du dernier groupe. L’écart est plus faible dans les ventes d’animaux. Il provient de la vente d’un nombre plus important d’animaux de réforme et surtout de taurillons et de génisses produits à partir de veaux nés sur l’exploitation. Il est par conséquent le résultat direct d’un faible taux de mortalité des veaux, du remplacement des vaches de race locale par celles de race améliorée et d’une alimentation meilleure et par conséquent plus coûteuse.
Les frais d’alimentation du premier groupe dépassent de 632 Dh par UGBB celles du groupe de queue. Les concentrés et les fourrages connaissent les écarts les plus élevés. Les élevages du dernier groupe sont moins intensifs, la consommation de la paille y est la plus forte.
Par S. BAALI et M. RAKI
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Contraintes et perspectives de développement pour l’Agriculture Méditerranéenne, Le Grusse Ph.[article] [présentation]
Le « Plan Maroc Vert »: une stratégie de développement innovante pour l’agriculture marocaine, A. Hajjaji [présentation]
Water management towards sustainable food production, Hamdy A. [article] [présentation]
Les changements climatiques: Impacts sur l’agriculture au Maroc, Benaouda H. et Balaghi R. [article] [présentation]
L’Economie et la Valorisation de l’Eau en Irrigation au Maroc: Un Défi pour la Durabilité de l’Agriculture Irriguée, Arrifi E. [article] [présentation]
Wastewater recycling and reuse in Mediterranean region as a potential resource for water saving and sustainable agriculture, Choukr-Allah R. [article] [présentation]
Élaboration d’un scénario optimal pour la mise en place d’un périmètre irrigué de réutilisation des eaux usées épurées à Settat (MAROC), Beraud J., Cadillon M., Chibani A., Lacassin JC., Moulay R’Chid M., Zahry M. [article]
Pédologie, doses et type d’irrigation, salinité, fertilisation: prise en compte des enjeux agronomiques dans la mise en place d’un projet de réutilisation des eaux usées épurées à Settat (MAROC), Beraud J., Cadillon M., Chibani A., Lacassin JC., Moulay R’Chid M., Zahry M. [article] [présentation]
Gestion des petits barrages et interaction eau/écosystème: une Évaluation communautaire participative, Ait lhaj A., Mimouni A., Sedki M., Wifaya A., Rhajaoui M., Laamrani H., Boelee E., et Deplaen R. [article]
Caractérisation des pompages des eaux souterraines et étude de leurs performances techniques dans la zone côtière du Gharb, Hammani A. et Yechi H. [article] [présentation]
Évaluation de la qualité des eaux de la nappe de la côte orientale du Cap-Bon en Tunisie, Benalaya A., Chkirbene A., Jallali S., Harbaoui K. et Tarhouni J. [article] [présentation]
Improving water productivity of crops in the Mediterranean region: case of cereals, Karrou M. and El Mourid M. [article]
Stratégies de valorisation de l’eau dans les systèmes de culture pluviale en zones arides au Maroc, Jouve Ph. [article] [présentation]
Valorisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de complément de l’olivier (olea europaea): effets sur les comportements végétatif et productif de l’arbre et sur la qualité sanitaire des fruits, Trad Raïs M., Sifi S., Xanthoulis D. [article]
Systèmes d’irrigation et économies d’eau sous climat méditerranéen: Etude expérimentale et modélisation, Mailhol J.C., Ruelle P., Khaledian M.R., Mubarak I., Rosique P. [article]
Adaptation du modèle «Mosicas» de croissance de la canne à sucre aux conditions de la région du Gharb au Maroc, Aabad M., Martiné J F., Bouaziz A. et Falisse A. [article]
Simulation par le modèle «Mosicas_Ma» de scénarios pour améliorer l’Efficience d’Utilisation de l’Eau d’Irrigation «EUEI» par la canne à sucre au Gharb, Maroc, Aabad M., Martiné JF., Falisse A., Bouaziz A. et El-Messaoudia M. [article]
Besoins en eau de différentes variétés de blé dur en conditions semi-arides, Bouthiba A., Debaeke P. [article]
Pratiques d’irrigation du palmier dattier dans les systèmes oasiens du Tafilalet, Maroc, Renevot G ., Bouaziz A., Ruf T. et Raki M. [article] [présentation]
Le cactus opuntia, une espèce fruitière et fourragère pour une agriculture durable au Maroc, Arba M. [article] [présentation]
Comparaison de cultivars d’artichaut multipliés par semis et plantés sous quatre densités dans la région du Gharb au Maroc, Elattir H., Skiredj A., Ait-Ben Oussaiden R. et Chtaina N. [article] [présentation]
Compostage et valorisation des déchets oasiens pour l’amélioration des sols et de la productivité, Bouhaouach H., Culot M. et Kouki K. [article] [présentation]
Impact de l’intensification agricole sous irrigation sur la qualité physique du sol, Oussible M. et Bourarach E. [article] [présentation]
Le semis direct pour une agriculture pluviale de conservation, El Gharras O., ElBrahli A., ElAissaoui A. et El Hantaoui N. [article] [présentation]
Le Silicium; le levier minéral indispensable pour une agriculture Durable au Maroc, Bouzoubaâ Z.; Ait Lhaj A. et Mimouni A. [article] [présentation]
Biopesticides: Alternatives à la lutte chimique?, El Guilli M., Achbani E., Fahad K. et Jijakli H. [article]
Quels outils pour concevoir, conduire et évaluer des systèmes de culture adaptés à la contrainte hydrique ?, Debaeke P. [article] [présentation]
Les formes d’organisation des exploitations agricoles et les pratiques céréalières en milieu semi-aride de l’Est Algérien, Benniou R. et Aubry C. [article] [présentation]
Organic Farming in the World, and case study of Morocco: Achievements, Drawbacks and Future Perspectives, Alaoui SB. [article] [présentation]
Agronomie et conception de systèmes de production innovants: concepts, démarches et outils, Le Gal P.-Y. [article] [présentation]
Olive Value Chain Analysis in the Haouz Area, Serghini H., Arrach R. and Aw-Hassan A. [article]
Filière sucrière et Valorisation des Ressources au Maroc, Doukkali M.R, Redani L. et Lebailly Ph. [article] [présentation]
Améliorer les performances de la filière bovine laitière en irrigué au Tadla: de l’analyse de la valorisation de l’eau à l’accompagnement des acteurs, Sraïri M.T., Le Gal P.-Y. et Kuper M. [article] [présentation]
Effets de quelques itinéraires de travail du sol en zones semi-arides sur l’humidité du sol, Benfreha M. et Mederbal K. [article]
Germination et taux de survie chez trois espèces de médics annuels, Ayari A., Ben Mansoura A., Rejeb M-N. et Henchi B. [article]
Diversité des Rhizobia qui nodulent quelques légumineuses de la région orientale du Maroc, Guerrouj K., Benata H., Ourarhi M., Abdelmoumen H., Paul R. et Missbah El Idrissi M. [article]
Efficacité des herbicides sur l’ivraie raide (Lolium rigidum), Tanji A. [article]
Quelques résultats intéressants d’économie d’eau par l’utilisation du tube poreux: application à un verger de pommier en zone aride (Algérie), Benabdeli K. [article]
Détermination des coefficients culturaux de la variété d’oranger «Maroc late» au périmètre irrigué de Tadla, Bouazzama B. et Bahri A. [article]
Préparation des charbons actifs à partir des déchets de l’industrie oléicole, Ounas A., Bergach N., Ennaciri K., Yaacoubi A. et Bacaoui A. [article]
Analyse préliminaire de la pollution de quelques sols par les HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques) pour une agriculture durable, Djellouli M., Esposito V., Taleb S., Benghalem A. et Tundo P. [article]
Fighting the urban-rural mismatch by modernizing and adapting periurban agriculture to today’s challenges and opportunities in the Casablanca Region, Helten F. and Ouchker J. [article]
Expérience du Programme Oasis Tafilalet pour le développement de l’agro-écologie, Haddouch M. [article]
Effet de l’irrigation supplémentaire et du génotype sur la production du blé tendre et l’efficience d’utilisation de l’eau dans la région du Saïs, Bendidi A., Dahan R., Daoui K., Hadarbach D. et Khalfi C. [article]