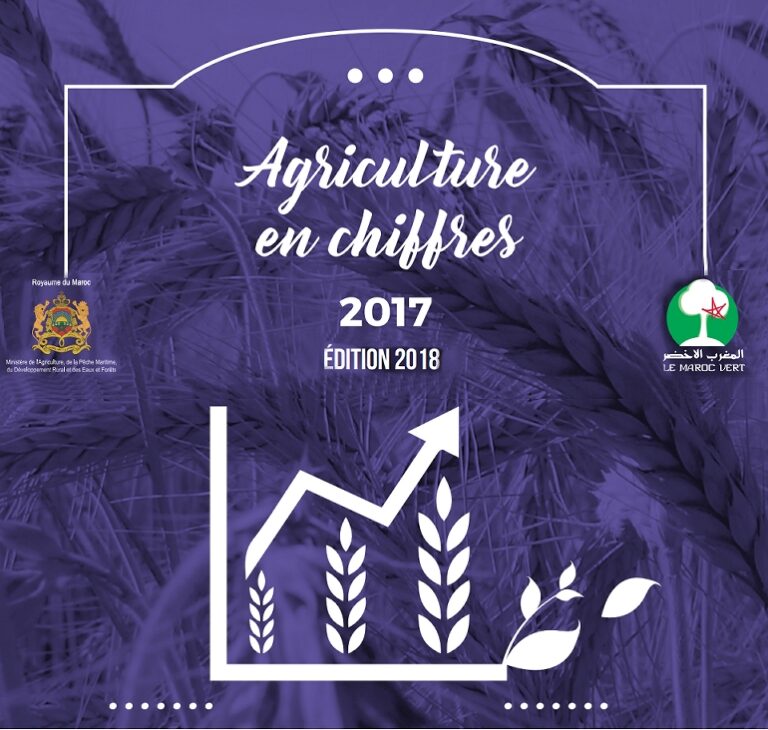Les diagnostics agronomiques réalisés dans le périmètre des Doukkala ont montré que l’efficience d’utilisation de l’eau d’irrigation, en terme de quantité de produits agricoles par m3 d’eau, mérite d’être améliorée. Si elle est bien raisonnée, la fertilisation minérale est une des techniques culturales permettant de mieux valoriser l’eau d’irrigation.
L’utilisation rationnelle des engrais dépend de la richesse initiale du sol en éléments fertilisants, du type de sol, du stade d’apport et du niveau de rendement visé.
La détermination des normes d’interprétation des résultats d’analyses de sol est une étape indispensable dans le processus de calcul des plans de fumure des cultures. Cependant, malgré les efforts importants déployés durant la dernière décennie par l’ORMVAD et les autres partenaires tels que la COSUMAR, la SASMA, la DPV et l’IAV Hassan II, la pratique de la fertilisation de la betterave à sucre et des céréales dans les Doukkala n’est pas encore bien maîtrisée. En effet, les recommandations ne tiennent pas encore compte de la richesse initiale du sol en éléments fertilisants.
L’objectif principal de cette étude est l’établissement de normes d’interprétation des résultats des analyses de sol pour la fertilisation de la betterave et du blé sur les principaux types de sol du périmètre des Doukkala. Ainsi, les agriculteurs pouvant faire l’analyse de sol de leurs parcelles avant l’installation de la culture peuvent calculer les quantités d’engrais nécessaires en fonction de la richesse des sols de leurs parcelles. Pour ceux n’ayant pas cette possibilité, des formules moyennes sont proposées à la lumière de la richesse moyenne de la majorité des parcelles de la région ou de l’arrondissement dont ils font partie.
Après une présentation succincte de la méthodologie, ce bulletin résume les principaux résultats obtenus, les normes établies et les nouvelles formules proposées pour la fertilisation du blé et de la betterave en irrigué dans le périmètre Bas-Service des Doukkala. Enfin, des actions d’accompagnement sont recommandées.




 La production annuelle mondiale de bromure de méthyle a été estimée à 76.000 tonnes dont 70% sont utilisées dans la désinfection des sols contre les parasites et ravageurs des plantes, notamment les nématodes, les champignons et les mauvaises herbes. Le reste est destiné à la désinsectisation des locaux de stockage de produits agricoles, des infrastructures industrielles et aux traitements des marchandises contre les maladies et ravageurs de quarantaine.
La production annuelle mondiale de bromure de méthyle a été estimée à 76.000 tonnes dont 70% sont utilisées dans la désinfection des sols contre les parasites et ravageurs des plantes, notamment les nématodes, les champignons et les mauvaises herbes. Le reste est destiné à la désinsectisation des locaux de stockage de produits agricoles, des infrastructures industrielles et aux traitements des marchandises contre les maladies et ravageurs de quarantaine.
 Le TYLCV une grave virose introduite accidentellement au Maroc
Le TYLCV une grave virose introduite accidentellement au Maroc
 Dans les périmètres irrigués, les rendements du blé et de l’orge sont largement inférieurs au potentiel de production. Pourtant, des efforts considérables ont été faits au niveau de l’équipement hydro-agricole pour amener l’eau jusqu’aux parcelles. D’ailleurs, les études d’intensification de la production du blé, réalisées dans certains périmètres irrigués, ont démontré la possibilité d’obtenir des rendements grain dépassant 50 qx/ha.
Dans les périmètres irrigués, les rendements du blé et de l’orge sont largement inférieurs au potentiel de production. Pourtant, des efforts considérables ont été faits au niveau de l’équipement hydro-agricole pour amener l’eau jusqu’aux parcelles. D’ailleurs, les études d’intensification de la production du blé, réalisées dans certains périmètres irrigués, ont démontré la possibilité d’obtenir des rendements grain dépassant 50 qx/ha.

 Sommaire
Sommaire