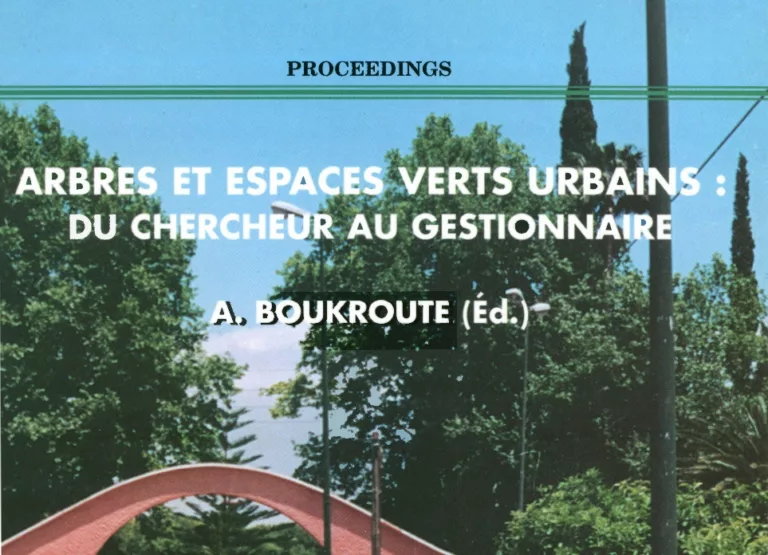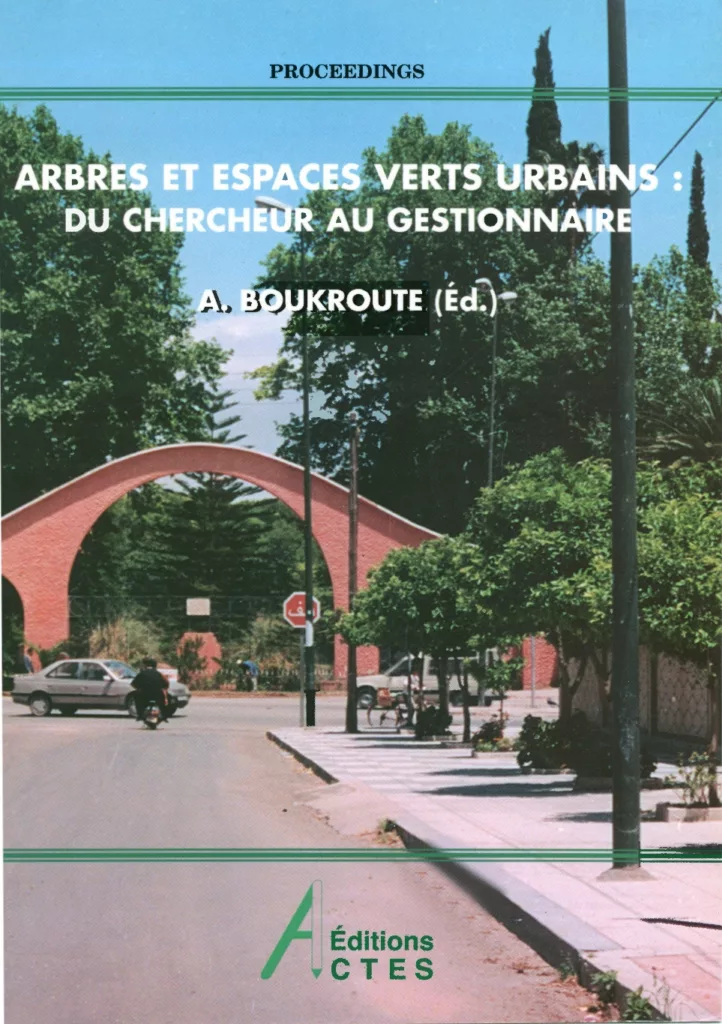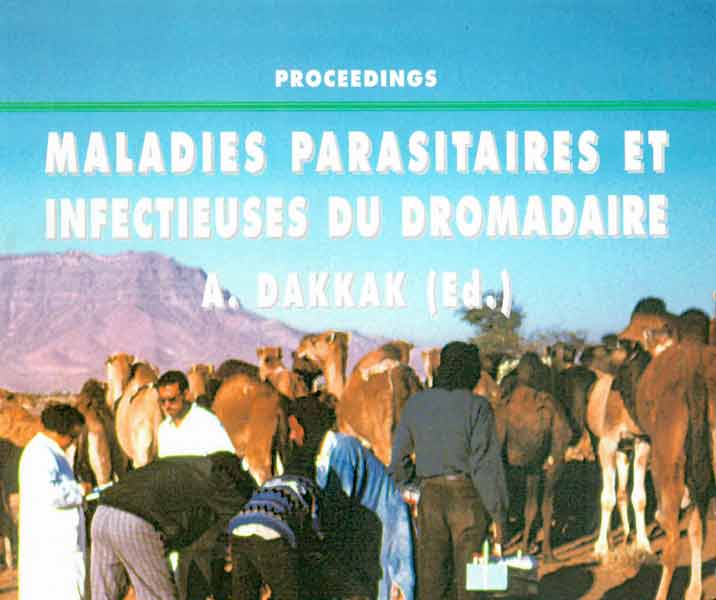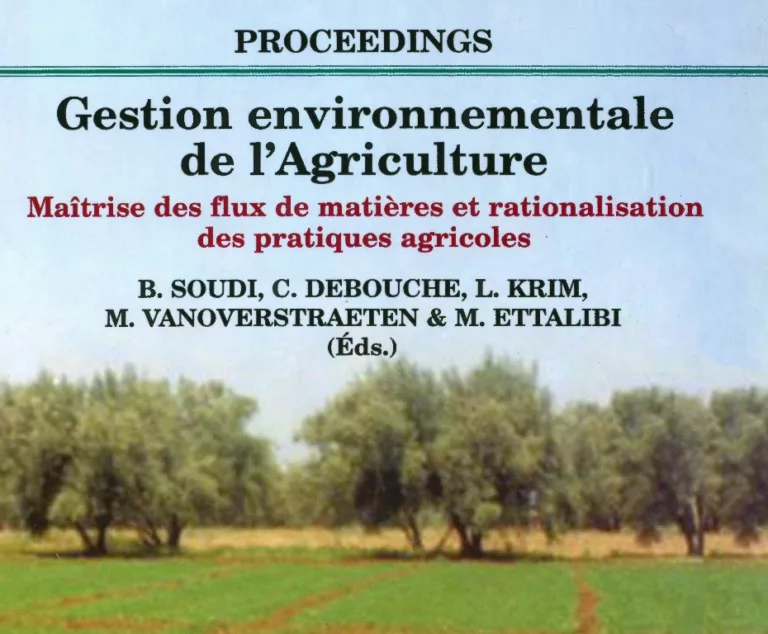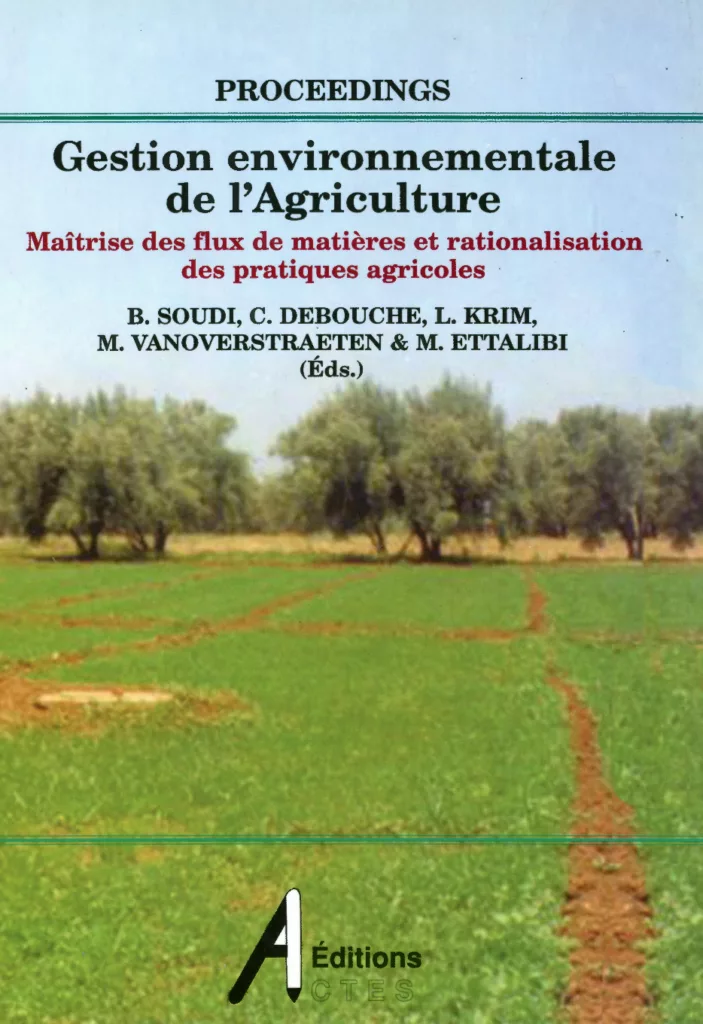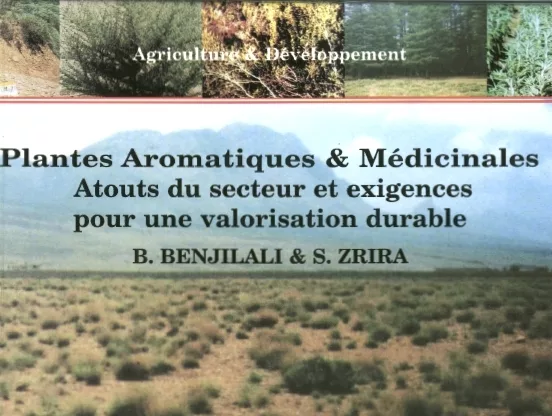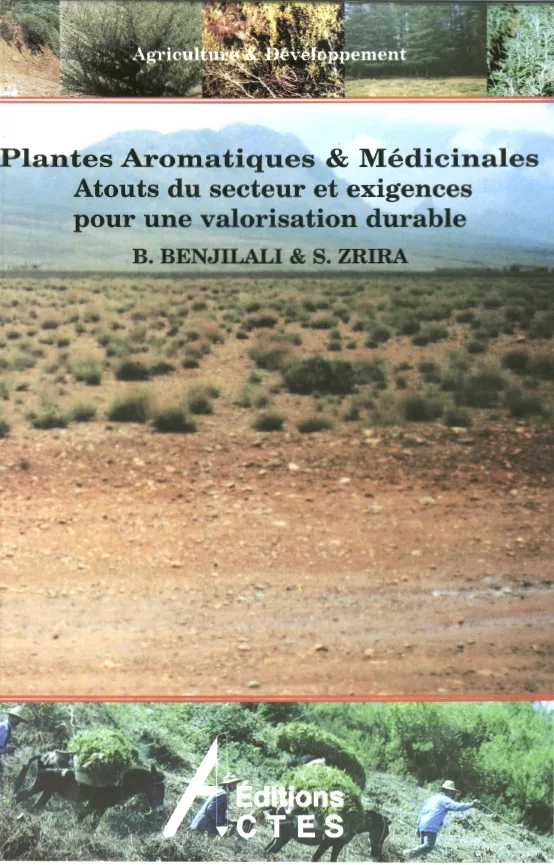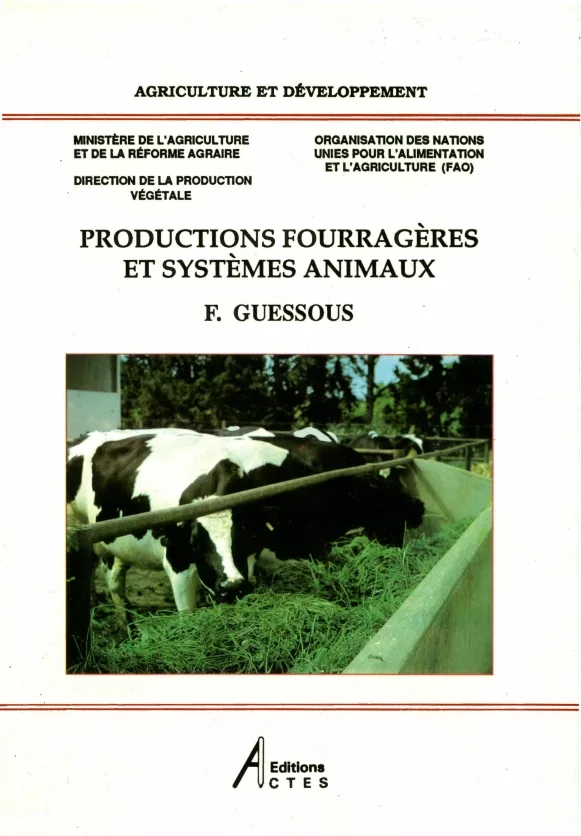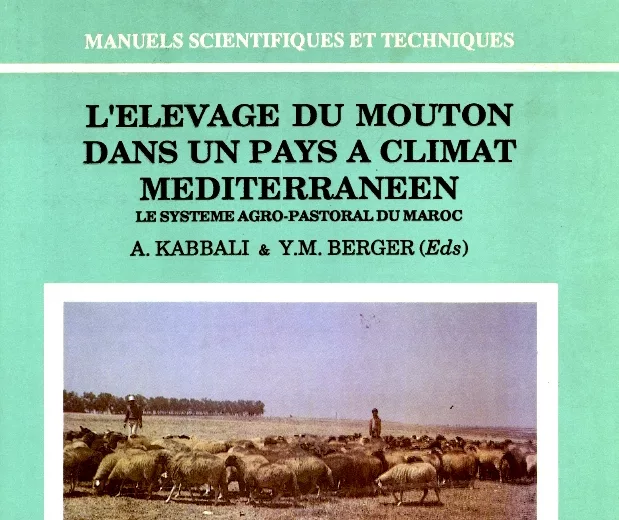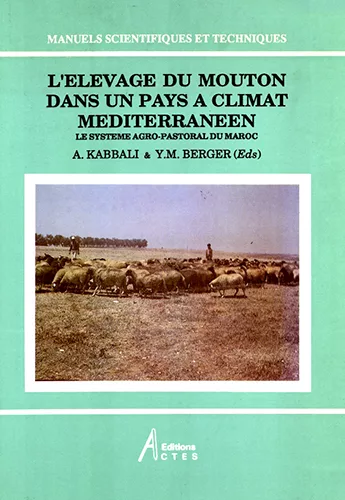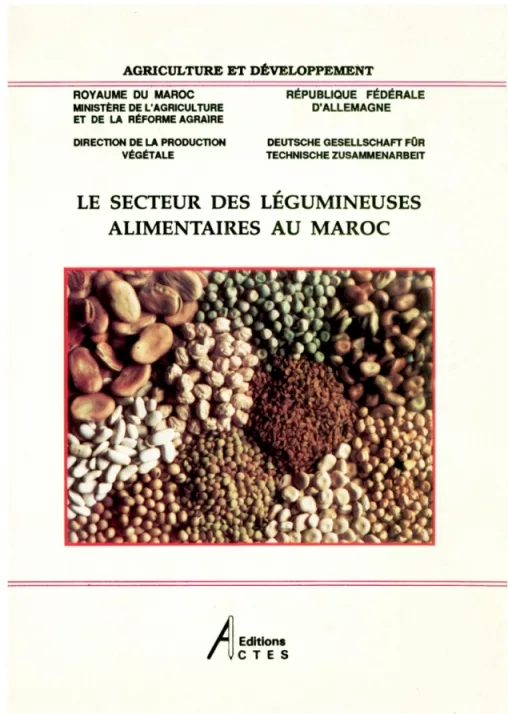Arbres et espaces verts urbains: du chercheur au gestionnaire
A.BOUKROUTE (Ed.), Proceedings
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Laboratoire d’Amélioration et de Production Végétales, Oujda, Maroc
Faisant suite à des rencontres internationales organisées dans le domaine du végétal en milieu urbain, notamment le colloque international sur « la plante dans la ville » (novembre 1996, Angers, France), le symposium international sur « la santé de l’arbre urbain » (septembre 1997, Paris, France) et le symposium international sur « la santé de la plante en horticulture urbaine » (mai 2000, Braunschweig, Allemagne), le colloque international intitulé « Arbre et Espaces verts urbains: du chercheur au gestionnaire » (septembre 2001, Oujda, Maroc) s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université, en particulier marocaine, sur son environnement socio-économique.
L’objectif essentiel du colloque international d’Oujda est de réunir chercheurs et professionnels qui s’intéressent à l’arbre en ville et aux espaces verts, d’une manière générale, afin de débattre cette importante thématique, d’évaluer la situation actuelle et de faire des propositions dans le but de choisir les meilleures solutions à l’avenir.
Sommaire
- 00-Préface
- 01-Espaces verts dans les documents d’urbanisme et problématique de réalisation: cas de la ville d’Oujda (Maroc), Majid MANSOUR et Mohamed BERHILI
- 02-Étude comparative de deux modèles d’aménagement des ceintures vertes périurbaines à Tunis et Paris: analyse des politiques publiques de protection des espaces naturels/agricoles dans deux territoires périurbains (le plateau de Saclay, à Paris, et la plaine de Sijoumi, à Tunis), Moez BOURAOUI et Pierre DONADIEU
- 03-Statut juridique de l’arbre en ville: entre les textes et les pratiques, cas de la ville de Fès, Valérie CLAES, Ahmed GOURARI et Samir EL JAAFARI
- 04-Jardins et espaces verts de la Principauté de Monaco: présentation et textes réglementaires, Georges RESTELLINI et Christian FIGHIERA
- 05-Statut juridique de l’arbre dans le droit marocain, Mohammed BEDHRI
- 06-Importance de la conception pour l’aménagement des espaces libres urbains, Chérif HARROUNI
- 07-Problématique de gestion de l’arbre en milieu urbain (Maroc), Brahim JAAFAR et Mohamed Said KAHOUADJI
- 08-Gestion des espaces verts publics urbains au Maroc: cas des villes d’Agadir, Ahfir et Berkane, Mohammed MELHAOUI, Mimoun MOKHTARI et Chérif HARROUNI
- 09-Gestion des espaces verts urbains: nécessité d’une approche basée sur la sensibilisation et la participation des acteurs locaux, Samir EL JAAFARI, Latifa QARIANI, Valérie CLAES et Anass ALJ
- 10-Gestion des espaces verts urbains: cas de la ville d’Oujda, Noureddine KOUDDANE, Ouafae MOKHTARI et Zahira MSILIH
- 11-D’autres arbres et arbustes pour les villes méditerranéennes: un outil pour le choix d’espèces sauvages à fortes potentialités, Catherine DUCATILLION
- 12-Exploitation du caroubier (Ceratonia siliqua L.) dans la Commune d’Aïn Beïda, région de Chefchaouen, Naoual GHARNIT, Noureddine EL MTILI, Ahmed TOUBI ENNABILI et Abdeslam ENNABILI
- 13-Rôle de la société civile dans la sauvegarde du végétal: expérience de l’Association Amis de l’Environnement (AAE), Adnane EL GHAZI
- 14-Élagage des arbres d’alignement: adéquation entre physiologie et économie, André TOUSSAINT, Vincent KERVYN de MEERENDRE, Bernard DELCROIX et Jean-Pierre BAUDOIN
- 15-Essai de germination des graines de caroubier (Ceratonia siliqua L.) et effet de l’acide gibbérellique sur la croissance végétative des plantules, Mohamed REDA TAZI, Abdelbasset BERRICHI, Noureddine KOUDDANE, Mohamed TOHAMI et ZD HOUNKPEVI
- 16-Possibilités de revitalisation des arbres urbains, Mohamed Wafi MHAMDI, Murielle EYLETTERS et Roger PAUL
- 17-Diagnostic et évaluation de certains ligneux dans l’environnement urbain de la ville de Tunis, Hicham REJEB, N. SOUAYAH, N. OUERFELLI et D. GANOUNI
- 18-Dépérissement des Platanes (Platanus acerifolia Willd) dans la ville d’Oujda: causes et mesures envisageables, Azzouz BOUKROUTE, Jaouad MERIMI, Ahmed EL AMRANI, Ahmed KHALID, Zahra KHARMACH, Hana SERGHINI et Noureddine KOUDDANE
- 19-Recommandations
- 20-Liste des participants
- 21-Table des matières